1 Le brevet au Royaume-Uni
302._ Présentation générale (et quelques chiffres)_ Le système des brevets du Royaume-Uni est un des principaux systèmes européens de brevets en termes de dépôts. Pour l’année 2023, 19 343 demandes de brevet (demandes directes et entrées dans la phase nationale du PCT) ont été déposées auprès de l’Office de propriété intellectuelle du Royaume-Uni (Intellectual Property Office, UKIPO), et 8 374 brevets ont été accordés (contre 10 576 en 2022)[1]. Ces chiffres sont comparables à ceux de la France[2], mais largement inférieurs à ceux de l’Allemagne[3]. Ils sont relativement stables sur les dernières années[4]. Le Brexit, qui n’affecte pas la participation du Royaume-Uni au système du Brevet européen[5], ne semble pas avoir eu d’effets sur l’attractivité du système national.
Comme dans les autres pays européens concernés, la très grande majorité des brevets en vigueur au Royaume-Uni sont des brevets européens. Le nombre de demandes adressées à l’OEB, qui n’a cessé d’augmenter entre 2000 et 2019, est actuellement près de dix fois supérieur à celui des demandes auprès de l’UKIPO[6]. 91% de tous les brevets en vigueur au Royaume-Uni seraient des brevets européens[7].
La plupart des demandes déposées à l’UKIPO proviennent de déposants britanniques. Leur proportion a cependant diminué, passant de 69 % de l’ensemble des demandes en 2000, à 58 % en 2020[8].
303._ Environnement international (renvoi)_ Nous renvoyons, s’agissant du cadre international applicable au Royaume-Uni, aux développements du Tome 1 de cet ouvrage[9]. Rappelons ici que le Royaume-Uni est signataire (et souvent de longue date) de la plupart des grandes conventions internationales en matière de brevet, et notamment, au-delà de la Convention de Paris et de l’accord ADPIC, du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) de 1970 [10], de l’Arrangement de Strasbourg sur la classification internationale des brevets de 1971[11], du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets de 1977[12], et du Traité sur le droit des brevets (PLT) de 2000[13]. Au niveau régional, le Royaume-Uni est bien sûr signataire de la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973[14]. Précisons que le cadre juridique établi par la CBE, qui n’est pas un instrument issus du droit de l’Union européenne, n’a pas été affecté par le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
A ces conventions s’ajoutent désormais l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord, d’autre part (Accord UE/RU)[15] conclu le 24 décembre 2020, et entré provisoirement en vigueur le 1er janvier 2021, qui est venu prolonger les dispositions de l’accord de sortie, en sécurisant les relations futures entre l’UE et le RU. Il en sera question ci-dessous.
Enfin, après avoir indiqué en novembre 2016 qu’il entendait ratifier l’Accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet (AJUB) [16], le Royaume-Uni a finalement renoncé à rejoindre le système du brevet unitaire[17].
304._ Les effets du Brexit (renvoi)_ Nous renvoyons sur les effets du Brexit en matière de propriété intellectuelle à nos développements du Tome 1 de cet ouvrage[18].
Rappelons ici que les suites données au référendum du 24 juin 2016 ayant confirmé le désir d’une majorité de citoyens britanniques de mettre fin à quarante-trois années d’appartenance à l’Union européenne (« Brexit ») ont été précisées dans l’Accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne (UE) et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), finalement publié (après quelques péripéties) le 14 novembre 2018[19]. Cet accord a été ratifié par le Parlement européen le 29 décembre 2018, permettant la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne (et de l’Espace économique européen) le 31 janvier 2020. Une période de transition a été mise en place jusqu’au 31 décembre 2020. L’accord a été mis en oeuvre au Royaume-Uni par les European Union (Withdrawal Agreement) Acts de 2018 et 2020 et leurs textes d’application.
L’accord de retrait contient des dispositions sur la propriété intellectuelle dans ses articles 54 à 61 (Titre IV, propriété intellectuelle, V. annexe 1 à cet ouvrage). Ces dispositions prévoient notamment le maintien de la protection au Royaume-Uni des droits enregistrés ou accordés[20], des facilités relatives aux procédures d’enregistrement[21], le maintien de la protection au Royaume-Uni d’enregistrements internationaux désignant l’Union[22], le maintien de la protection des dessins ou modèles communautaires non enregistrés[23], de la protection des bases de données[24], un droit de priorité en ce qui concerne les demandes en instance de marques de l’Union européenne, de dessins ou modèles communautaires et de protection communautaire des obtentions végétales[25], et des règles concernant les demandes en instance de certificats complémentaires de protection au Royaume-Uni[26].
L’accord prévoit également des règles en matière d’épuisement des droits; il dispose que les droits de propriété intellectuelle qui ont été épuisés tant dans l’Union qu’au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les conditions prévues par le droit de l’Union restent épuisés tant dans l’Union qu’au Royaume-Uni[27].
Les différents textes réglementaires mettant en œuvre les dispositions de l’accord sur la propriété intellectuelle, pris en application des European Union (Withdrawal Agreement) Acts 2018 et 2020[28], sont entrés en vigueur le 1er janvier 2021.
En matière de brevets, les règles posées par l’accord de retrait, qui ne visent que les demandes de certificats complémentaires de protection en instance au Royaume-Uni, ont été transposées par les Patents (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, qui modifient le Patents Act 1977 et d’autres textes pertinents. Rappelons que l’article 60 de l’accord de retrait prévoit que les règlements 1610/96 et 469/2009 s’appliquent respectivement aux demandes de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques et pour les médicaments, ainsi qu’aux demandes de prolongation de la durée de ces certificats, lorsque ces demandes ont été présentées à une autorité du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les cas où la procédure administrative relative à l’octroi du certificat concerné ou à la prolongation de sa durée était en cours à la fin de la période de transition. Tout certificat accordé en vertu de ce texte offre le même niveau de protection que celui prévu par les règlements 1610/96 et 469/2009. Pour le reste du droit de l’Union, à savoir les dispositions de la directive 98/44/CE du Parlement relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, et les règles concernant les certificats complémentaires de protection, le EU Withdrawal Act 2018, non modifié sur ce point par le Withdrawal Act 2020, prévoit le maintien par défaut de l’acquis communautaire. Cet acquis pourra cependant être modifié, sous réserve du respect des accords internationaux applicables.
Par ailleurs, comme indiqué, la sortie de l’Union n’affecte pas la participation du Royaume-Uni au système du brevet européen.
Enfin, bien qu’ayant ratifié l’accord sur la juridiction unifiée et le protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet, le Royaume-Uni s’est retiré du système du brevet unitaire, pour des raisons principalement politiques tenant à la compétence de la CJUE.
L’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (Accord UE/RU)[29] conclu le 24 décembre 2020, est venu prolonger les dispositions de l’accord de sortie, en sécurisant les relations futures entre ses parties. Il est entré provisoirement en vigueur le 1er janvier 2021. Son titre V, consacré à la propriété intellectuelle[30], définit un minimum conventionnel qui reprend assez sommairement les grandes lignes de l’acquis communautaire dans ce domaine; on relèvera cependant quelques absences notables, concernant par exemple le droit sui generis sur les bases de données, certains aspects de la protection des dessins et modèles, les indications géographiques et l’épuisement des droits. L’Accord contient également des dispositions sur les secrets d’affaires et la défense des droits.
Sous réserve de renvois à la déclaration de Doha et à l’accord ADPIC, les dispositions de l’accord UE/RU en matière de brevets[31] ne portent que sur les certificats complémentaires en matière de médicaments et de produits phytopharmaceutiques. L’accord prévoit que « les modalités et conditions d’octroi de cette protection supplémentaire, y compris sa durée, sont déterminées conformément à la législation et à la réglementation des Parties ». L’accord contient également des dispositions sur la protection des données d’AMM de médicaments (pendant une période limitée à déterminer en vertu du droit interne)[32] et de produits phytopharmaceutiques ou biocides (d’au moins 10 ans à compter de l’octroi de la première autorisation accordée par une autorité compétente sur le territoire de la partie)[33].
305._ Plan_ Après une rapide, mais nécessaire, introduction historique (I), nous aborderons classiquement les conditions de protection (II) et les règles relatives à l’exploitation (III). Nous renvoyons aux développements du Tome 1 sur les procédures et les sanctions[34].
1. Introduction historique
306._ Avant le Statute of Monopolies_[35] La protection des brevets a pour origine le système des privilèges qui s’est développé, en Angleterre, comme dans la plupart des États d’Europe occidentale, à partir du quatorzième siècle. Le souverain accordait ainsi des lettres patentes (literae patentes, lettres ouvertes accompagnées du sceau du souverain) donnant aux importateurs ou aux fabricants de produits ou de procédés nouveaux des privilèges de commercialisation[36]. Ces patents of monopolies étaient évalués par un comité établi auprès du Privy Council. Cette prérogative royale constituait, nous l’avons vu, une exception au principe de liberté du commerce et de l’industrie, consacré par la Magna Carta[37]. Les privilèges étaient donc en principe limités aux produits et procédés nouveaux et utiles. Leur durée était variable, mais une durée de sept ans, correspondant à un cycle d’apprentissage, était fréquente.
Ce pouvoir ne fut pas uniquement exercé pour récompenser les efforts des explorateurs et autres importateurs de produits et de procédés nouveaux. Il servait également des fins clientélistes, et constituait un moyen assez simple (notamment sous les Tudors) pour remplir les caisses de la Couronne. En effet les patents of monopolies donnaient lieu au paiement de redevances, et constituaient une forme de taxation indirecte, permettant de compenser les pertes liées aux réticences de Parlement de voter ou d’augmenter les taxes directes sur la landed gentry. La Couronne en vint à accorder des lettres patentes conférant des monopoles sur des produits de première nécessité et à la nouveauté contestable. De 1561 à 1590, Elisabeth 1er en avait accordé près d’une cinquantaine, dont beaucoup sur des denrées et produits aussi importants que le savon, le sel, le papier, le verre et l’huile[38].
Ce système, qui entraînait une hausse des prix de ces produits, devint très impopulaire. En 1601, devant les protestations de la Chambre des communes dirigées contre ces « odieux monopoles », Elisabeth 1er annulera certains privilèges et permettra, de manière générale, leur contestation devant les cours de common law[39]. Les tribunaux refuseront alors à plusieurs reprises de donner effet à certaines lettres patentes. Ainsi, en 1602, dans la célèbre affaire Darcy v Allin[40] (autrement dénommée « affaire des monopoles »), un monopole portant sur la fabrication, l’importation et la vente des cartes à jouer fut annulé sur le fondement de la common law, au motif qu’il constituait une restriction injustifiée à la liberté du commerce. Le roi James Ier fut par la suite contraint d’émettre plusieurs proclamations contre les monopoles. Il adopta le « Book of Bounty » (livre des récompenses[41]), publié en 1610, qui interdit l’octroi de monopoles, sauf ceux portant sur les inventions et produits nouveaux, et à condition que le monopole ainsi conféré ne soit pas contraire aux lois et préjudiciable à l’état et au public. C’est la naissance de la notion d’intérêt public à la base de la protection par brevet.
En 1615, dans l’affaire des Clothworkers of Ipswich[42], la Cour de King’s Bench confirma la prérogative royale d’accorder des privilèges exclusifs sur une invention nouvelle ou un commerce nouveau pour un temps limité.
307._ Du Statute of Monopolies au Patents Act 1977_ Cependant, en 1621 la Chambre des Communes s’opposa à nouveau aux monopoles, et en 1624 (et non pas en 1623, en dépit des nombreuses datations dans ce sens, notamment de la version du texte toujours en vigueur[43]) le Parlement anglais adoptera le Statute of Monopolies (« An Act concerning Monopolies and Dispensations with Penal Laws, and the Forfeitures thereof » )[44], qui annule les prérogatives royales de lettres patentes et introduit un système général de protection des inventions et importations nouvelles et utiles. Le texte recevra assentiment royal en mai 1624 et entrera en vigueur la même année.
Le Statute of Monopolies est avant tout une loi de concurrence, d’ordre public économique. Le système de droits exclusifs mis en place est clairement présenté comme une exception au principe d’abolition des monopoles, et est assez strictement encadré du point de vue de son exercice. La loi conférait un monopole de quatorze ans[45] au premier inventeur (true and first inventor) ou importateur d’une invention nouvelle, tout en limitant la durée des lettres patentes existantes à vingt-et-un ans. Elle interdisait également, et dans des termes très précis, d’abuser de ce monopole[46].
English Statute of Monopolies, 1624, 21 Jac.I, c.3. (extrait) (texte en anglais moderne)
An Act concerning Monopolies and Dispensations with Penal Laws, and the Forfeitures thereof
1. (…) BE IT ENACTED, that all monopolies and all commissions, grants, licenses, charters, and letters patents heretofore made or granted, or hereafter to be made or granted to any person or persons, bodies politic or corporate whatsoever, of or for the sole buying, selling, making, working, or using of anything within this realm or the dominion of Wales, or of any other monopolies, or of power, liberty, or faculty, to dispense with any others, or to give licence or toleration to do, use, or exercise anything against the tenor or purport of any law or statute; or to give or make any warrant for any such dispensation, licence, or toleration to be had or made; or to agree or compound with any others for any penalty or forfeitures limited by any statute; or of any grant or promise of the benefit, profit, or commodity of any forfeiture, penalty, or sum of money that is or shall be due by any statute before judgment thereupon had; and all proclamations, inhibitions, restraints, warrants of assistance, and all other matters and things whatsoever, any way tending to the instituting, erecting, strengthening, furthering, or countenancing of the same, or any of them, are altogether contrary to the laws of this realm, and so are and shall be utterly void and of none effect, and in no wise to be put in ure[use] or execution.
(…)
6 (a ). Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patents (b ) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm (c ) to the true and first inventor (d ) and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e ), so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient (f ): the same fourteen years to be acccounted from the date of the first letters patents or grant of such privilege hereafter to be made, but that the same shall be of such force as they should be if this act had never been made, and of none other (g).
(…)
Le Statute of Monopolies, toujours en vigueur pour certaines de ses dispositions (hors brevets)[47], est une loi très courte. Son texte ne prévoyait ni dépôt, ni examen officiel, ni même une description de l’invention. Avec le temps, l’habitude sera prise de déposer les descriptions des inventions à la Chancellerie afin de prouver contre les contrefacteurs. Ce dépôt deviendra une exigence des officiers de la Couronne et des tribunaux.
Le système mis en place sera très bureaucratique et coûteux. Il prévoyait par exemple un dépôt séparé pour l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Ecosse. Les demandes de brevet devaient être portées devant sept bureaux différents, avec paiement de droits différents à chaque fois, et faire l’objet de deux signatures royales[48]. Leur consultation était payante, et les demandes ne faisaient l’objet d’aucune publication ou indexation officielle.
Il faudra attendre 1852 pour que la Grande-Bretagne se dote d’une nouvelle loi sur les brevets[49]. Cette loi donnait la possibilité d’enregistrer sa demande pour un prix modique, voire même une demande provisoire, qui devait être complétée dans l’année. Le dépôt était désormais effectué auprès du Patent Office et les descriptions, auparavant non publiées, pouvaient être consultées à la Patent Office Library. Cependant la loi ne prévoyait toujours pas d’examen officiel. Ce qui fragilisera fortement les brevets délivrés.
La loi suivante, le Patents, Designs and Trade Marks Act 1883[50] transposera les dispositions de la Convention Universelle de 1883. Elle instituait un examen des demandes, mais uniquement pour défaut formel ou insuffisance de la description. Aucune recherche documentaire d’antériorité n’était diligentée.
Le Patent Office commencera à rechercher les demandes des cinquante années précédentes en 1902, date de l’adoption du Patents Act 1902. Mais l’examen, à la différence des USA, sera limité à la nouveauté.
La jurisprudence dégagera progressivement le critère d’activité inventive (inventive steps)[51].
Le Patents Act de 1949[52] opèrera une codification des solutions jurisprudentielles et un simple dépoussiérage de la loi. Ainsi, jusqu’à l’entrée en vigueur du Patents Act 1977 le droit des brevets au Royaume-Uni présentait toujours des lacunes importantes: l’examen par le Patent Office ne portait que sur la nouveauté et les demandes antérieures, vérifiées par une recherche sur les demandes faites en Grande-Bretagne, et en Grande-Bretagne seulement, dans les 50 années précédentes; le contenu détaillé de la description pouvait rester caché pendant quatre ans; et seul un tiers pouvait opposer l’absence d’activité inventive, et ce uniquement en lançant une procédure distincte devant les tribunaux; la durée des droits était de 16 ans (depuis 1939 seulement). Le Patents Act 1977 mettra également officiellement fin au système des lettres patentes pour les inventions, qui sera remplacé par un certificat du Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks.
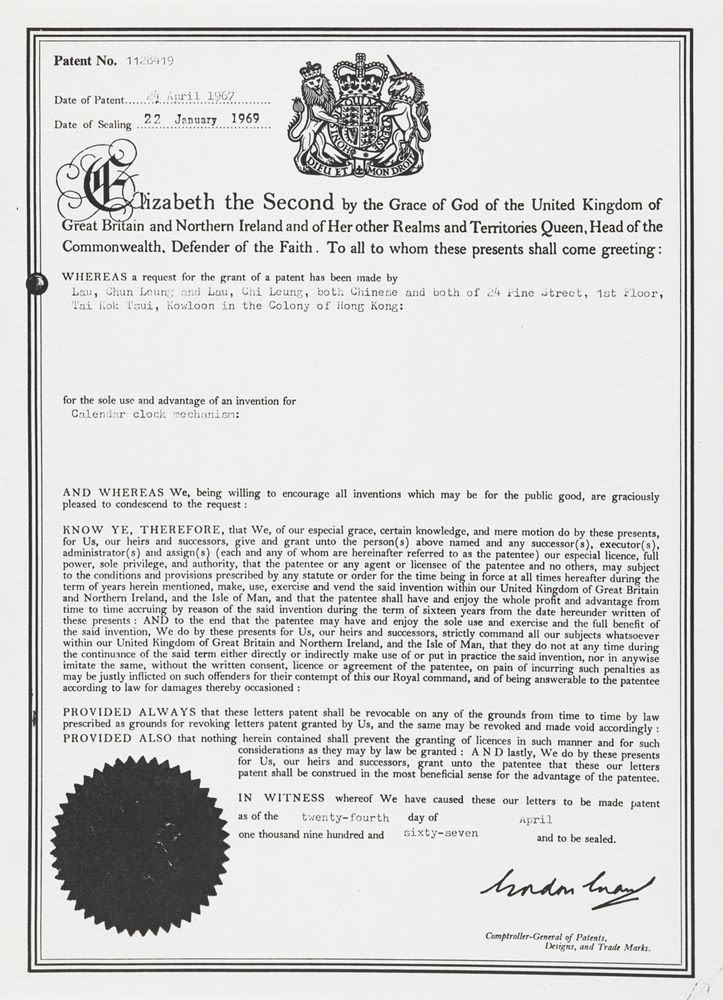
308._ Le Patents Act 1977_ Le Patents Act 1977[53] a apporté des modifications importantes à la législation alors en vigueur au Royaume-Uni, en mettant en oeuvre les principes et dispositions de la Convention sur le brevet européen de 1973, de la Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire de 1975 et du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) de 1970.
Il s’agit d’une loi imposante, dont certains articles sont développés sur plusieurs pages, suivie d’annexes volumineuses. La loi contient trois parties, consacrées au droit interne, aux dispositions de mises en oeuvres des obligations conventionnelles du Royaume-Uni, et à des dispositions diverses d’ordre procédural, administratif et interprétatif. Elles sont suivies de six annexes comprenant notamment les dispositions de droit transitoire.
Le Patents Act 1977 a été modifié à plusieurs reprises, notamment par le Copyright, Designs and Patents Act 1988 et le Patents Act 2004. La loi autorise le Secretary of State à réglementer le fonctionnement du Patent Office, devenu Intellectual Property Office. Cette réglementation prendra la forme des Patents Rules 1978, auxquelles se sont substituées les Patents Rules 1982, les Patents Rules 1990, les Patents Rules 1995, et en dernier lieu les Patents Rules 2007, entrées en vigueur le 17 décembre 2007[54].
La section 130(7) du Patents Act contient une règle importante, qui précise que plusieurs sections de la loi doivent recevoir, dans la mesure du possible, la même interprétation que celle donnée à leur équivalent dans la CBE, la CBC et le traité PCT[55]. Dans l’affaire Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. v H.N. Norton & Co Ltd[56], la Chambre des Lords (désormais Cour suprême) a jugé que les tribunaux du Royaume-Uni, dans leur application des dispositions visées par la section 130(7) du Patents Act, devaient suivre les décisions de l’OEB. Pour la Chambre des Lords « ces décisions ne lient pas au sens strict les cours du Royaume-Uni mais ont force d’autorité (are of great persuasive authority); tout d’abord, parce qu’il s’agit de décisions de cours spécialisées (…) traitant quotidiennement de la Convention OEB, et ensuite, parce qu’il sera hautement indésirable que les dispositions de la Convention soient interprétées différemment à l’OEB et par les cours nationales d’un État contractant »[57].
En conséquence de l’harmonisation issue de la CBE et de la directive 98/44/CE (dont les solutions ont été préservées par le EU Withdrawal Act 2018[58]), la protection des brevets au Royaume-Uni est assez proche du droit français, s’agissant de la brevetabilité et de l’étendue de la protection. Cependant, des différences subsistent. La plus importante concernait l’examen, qui constitue au Royaume-Uni un examen complet au fond[59]. Elle s’est estompée par l’effet de la réforme issue en France de la loi PACTE[60], qui impose la prise en compte, depuis le 22 mai 2020, de l’activité inventive pour la délivrance des brevets français. Les procédures applicables, avant et après délivrance, demeurent cependant différentes[61]. Le Patents Act 1977 ne prévoit pas non plus de certificats d’utilité ou de titres équivalents[62].
2. L’obtention du brevet
309._ Plan_ Nous distinguerons classiquement les conditions de fond (A) et de forme (B) de la protection.
A. Les conditions de fond
310._ En général_ La législation antérieure au Patents Act 1977 était très insuffisante dans sa définition de l’invention brevetable[63]. Le Patents Acts 1977 a repris les conditions de fond de la brevetabilité établies par la Convention sur le brevet européen (CBE). La section 1(1) du Patents Act dispose :
« Un brevet ne peut être délivré que pour une invention pour laquelle les conditions suivantes sont remplies :
a) l’invention est nouvelle ;
b) elle implique une activité inventive ;
c) elle est susceptible d’application industrielle ;
d) la délivrance d’un brevet pour cette invention n’est pas exclue par les alinéas 2) et 3) ou la section 4A ci-dessous
et les références à l’expression «invention brevetable» dans la présente loi doivent être interprétées en conséquence. »
Les sous-sections (2) et (3) visées au point (d) reprennent, en des termes voisins, les dispositions de la CBE[64]. La section 4A vise quant à elle les méthodes de traitement et de diagnostic[65].
311._ L’invention_ Le terme « invention » n’est pas défini dans la loi. La Chambre des Lords (désormais Cour suprême) a eu l’occasion d’aborder ce point en 1996 dans l’affaire Biogen Inc v Medeva plc[66], première décision portant sur la brevetabilité de produits issus du génie génétique. Elle y relève les difficultés posées par toute tentative de définition, ainsi que l’intérêt limité d’une telle discussion, au regard des conditions de la brevetabilité:
Biogen Inc v Medeva plc, [1996] UKHL 18
« 9. Qu’est-ce qu’une invention ?
43. La loi précise les diverses conditions, tant positives (aux paragraphes a) à c)) que négatives (au paragraphe d)) qu’une invention doit satisfaire pour être une « invention brevetable ». Ce schéma pourrait suggérer que, logiquement, il faut d’abord déterminer si l’invention revendiquée peut être correctement décrite comme une invention. Ce n’est que si cette question reçoit une réponse affirmative qu’il sera nécessaire d’examiner si l’invention remplit les conditions prescrites pour être « brevetable ». Dans la pratique, cependant, ce serait une erreur dans la plupart des cas, et source de difficultés inutiles.
44. La Loi ne définit pas la notion d’invention. La section 1(1) avait pour objet de reprendre, « dans la mesure du possible », l’article 52 de la Convention sur le brevet européen (« CBE ») : voir la section 130(7) du Patents Act 1977. L’article 52 ne contient pas non plus de définition de l’invention. Il semble que les parties à la CBE n’aient pas été en mesure de s’entendre sur ce point : V. Singer et Singer, The European Patent Convention (éd. anglaise 1995 par Ralph Lunzer), paragr. 52.04. Mais la raison pour laquelle les parties ont décidé de se passer d’une définition était qu’elles reconnaissaient que la question serait presque toujours théorique. Les quatre conditions énoncées au paragraphe 1(1) font beaucoup plus que restreindre les catégories d’« inventions » qui peuvent être brevetées. Elles contiennent probablement également tous les éléments du concept d’invention au sens ordinaire. Je dis probablement, parce qu’en l’absence d’une définition, on ne peut pas dire avec certitude que l’on ne trouverait pas quelque chose qui remplirait toutes les conditions mais ne pourrait pas être qualifié d’invention. Mais les rédacteurs de la Convention et de la loi, ainsi que les Conseils présents devant nous, n’ont pas pu en donner d’exemples. Au cas où la situation se présenterait, la section 1(5) donne au secrétaire d’État le pouvoir de modifier la liste des éléments exclus par l’alinéa (d) « dans le but d’assurer leur conformité avec les développements de la science et de la technologie ».
45. Étant donné que les quatre conditions sont relativement familières, clarifiées par les définitions de la loi et la jurisprudence des tribunaux et de l’OEB, il sera normalement plus commode de commencer par décider si elles sont satisfaites. Dans presque tous les cas, ce sera la fin de l’investigation. Il se peut qu’un jour il soit nécessaire de décider si quelque chose qui satisfait aux conditions de brevetabilité peut être qualifié d’invention, mais on peut attendre que la question se pose.
46. On peut bien sûr imaginer des cas où l’objet revendiqué n’est manifestement pas une invention, au point qu’il est tentant de s’attaquer au problème en rejetant la revendication sans s’enquérir de trop près de la condition qui n’a pas été remplie. C’est ainsi que, dans l’arrêt Genentech Inc. [1989] R.P.C. 147, 264, Mustill L.J. a déclaré, en se référant au sens ordinaire du mot « invention » : « Vous ne pouvez pas inventer l’eau, bien que vous puissiez certainement inventer des façons de la distiller ou de la synthétiser. » C’est évident, dans un tel cas, il peut sembler pédant de dire que l’eau ne satisfait pas à la condition énoncée à l’alinéa a) de la section 1(1) parce qu’elle n’est pas nouvelle. Malheureusement, la plupart des affaires portées devant les tribunaux sont plus complexes. Les juges seraient donc bien avisés de mettre de côté leur intuition ou opinion sur ce qui constitue une invention, jusqu’à ce qu’ils aient examiné les questions de nouveauté, d’inventivité, etc. En l’espèce, je crois que l’avocat de Medeva a eu raison de résister à l’invitation de la Cour d’appel de présenter des observations sur la question de savoir si les revendications constituaient une invention. »
Ce débat s’est également déplacé sur le concept de « découvertes », exclues de la brevetabilité[67], qui n’est pas plus défini par la loi. Les remarques précitées de Biogen sont très certainement également applicables ici, et plus largement à la distinction entre invention et découverte[68].
Sous ces réserves, le droit britannique admet de longue date qu’une invention puisse reposer sur une découverte[69]. Ainsi, dans l’affaire In Genentech Inc’s Patent[70], la Cour d’appel de Londres a jugé que la découverte d’une séquence d’acide aminé pouvait constituer une invention lorsqu’elle est incorporée dans un procédé de fabrication. Dans l’affaire Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel[71], la Chambre des Lords a quant à elle jugé qu’une séquence d’ADN, en tant que telle, constituait une simple découverte, mais qu’un procédé permettant de l’isoler et de l’extraire, ainsi que les produits ainsi obtenus, étaient bien constitutifs d’inventions.
312._ Les inventions générées par IA: la jurisprudence Thaler_ La question de la brevetabilité des inventions générées par des systèmes d’intelligence artificielle a été soumise aux tribunaux britanniques dans le cadre de l’affaire « Tahler », relative au système d’intelligence artificielle « DABUS » (pour Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience), qui a également connu des développements aux États-Unis[72] et auprès de l’OEB[73], mais également en Afrique du Sud[74] et en Australie[75] et en Nouvelle-Zélande[76],
En l’espèce, Stephen Thaler, créateur du système d’intelligence artificielle DABUS, prétendait que son système avait créé généré deux inventions, portant sur un nouveau type de conteneur d’aliments ou de boissons, et un nouveau type de balise lumineuse et sur nouvelle façon d’attirer l’attention en cas d’urgence. Ces inventions avaient fait l’objet en octobre et novembre 2018 de deux demandes de brevets nationaux[77]. Cependant aucune de ces demandes ne désignait un inventeur humain, les formulaires accompagnant les demandes indiquant que M. Thaler n’était pas un inventeur des inventions décrites. L’UKIPO notifiait alors à M. Thaler qu’il devrait déposer une déclaration attestant la qualité d’inventeur, c’est-à-dire une déclaration identifiant la ou les personnes qu’il croyait être l’inventeur ou les inventeurs de chacune de ces inventions, dans les seize mois suivant la date de dépôt[78]. Dans ses réponses, M. Thaler indiquait que ces deux inventions avaient été créées par DABUS, et qu’il avait acquis le droit au dépôt en tant que propriétaire de cette machine. Après quelques échanges, le Contrôleur rendait une décision de rejet le 4 décembre 2019[79], au motif que DABUS n’était pas une personne au sens des sections 7 (droit au dépôt) et 13 (mention de l’inventeur) du Patents Act, et donc pas un inventeur, et qu’en conséquence DABUS n’avait aucun droit pouvant être transféré à M. Thaler, ce dernier n’ayant pas plus droit à la délivrance d’un brevet au motif qu’il était propriétaire de DABUS.
La High Court, puis la Cour d’appel de Londres, avaient rejeté les recours formés par M. Thaler[80].
L’affaire avait ensuite été porté devant la Cour suprême du Royaume-Uni. Par arrêt du 20 décembre 2023[81], celle-ci confirme tout d’abord que l’inventeur au sens du Patents Act 1977 doit être personne physique, notamment sur le fondement de l’examen des dispositions des sections 7 (droit au dépôt, définition et l’inventeur) et 13 (mention de l’inventeur) du Patents Act 1977[82]:
Thaler v. Comptroller, [2023] UKSC 49.
« 56. (…) La structure et le contenu des sections 7 et 13 de la loi, en eux-mêmes et dans le contexte de la loi dans son ensemble, ne permettent qu’une seule interprétation : un inventeur au sens du Patents Act 1977 doit être une personne physique, et DABUS n’est pas du tout une personne, et encore moins une personne physique : Il s’agit d’une machine qui, en partant de l’hypothèse factuelle qui sous-tend la présente procédure, a créé ou généré par elle-même les avancées techniques divulguées dans les demandes. J’utilise délibérément ici le terme « progrès technique » plutôt qu’ « invention », et les termes « créer » ou « générer » plutôt que « concevoir » ou « inventer », pour éviter de préjuger de la première question que nous avons à trancher. Mais il est indiscutable que DABUS est une machine, pas une personne (qu’elle soit physique ou morale), et je ne comprends pas que le Dr Thaler suggère le contraire.
57. L’article 130 de la loi de 1977 dispose que le terme « inventeur » a le sens que lui donne la section 7. Comme nous l’avons vu, le paragraphe 7(3) prévoit que le terme « inventeur » s’entend, en ce qui concerne une invention, de l’auteur réel de l’invention. Rien n’indique que le terme « concepteur » a ici une signification autre que son sens ordinaire, c’est-à-dire désignant une personne qui conçoit un produit ou un procédé nouveau et non évident (l’invention), susceptible d’application industrielle et pouvant être protégée par le système des brevets.
58. Cette interprétation est également conforme à l’économie de la section 7 déjà mentionnée. Ainsi une demande de brevet peut être présentée par toute personne (section 7(1)). Et il existe une présomption réfragable selon laquelle la personne qui présente la demande a le droit de se voir accorder le brevet (section 7(4)).
59. Toutefois, un brevet ne peut être délivré qu’à une personne appartenant à l’une des trois catégories de personnes énumérées à la section 7(2). La première personne à qui un brevet peut être délivré est l’inventeur (article 7(2)(a)). Mais, de préférence à l’inventeur, il peut être accordé à une ou plusieurs personnes mentionnées à l’article 7(2)b), ou au successeur ou aux successeurs en titre de toute personne mentionnée aux alinéas a) ou b) (article 7(2)c)) – qui sont également des personnes dotées de la personnalité juridique, mais pas nécessairement des personnes physiques (…)
(…)
65. La section 13 confirme également qu’un inventeur doit être une personne. Je dois y revenir pour examiner les autres questions soulevées dans le présent pourvoi. Mais pour l’instant, il suffit de se référer à la section 13(1) qui confère à l’inventeur le droit d’être mentionné, et à la section 13(2) qui exige du déposant qu’il dépose la déclaration identifiant la ou les personnes qu’il croit être l’inventeur ou les inventeurs. Rien dans aucune de ces dispositions ne laisse entendre qu’un inventeur peut être une machine. »
Elle confirme également que le Patents Act 1977 ne donne pas le droit à une personne d’obtenir un brevet pour un produit ou procédé créé de manière autonome par une machine, notamment sur le fondement de son droit de propriété sur la machine[83].
La question du traitement des inventions relatives à l’intelligence artificielle est abordée plus loin[84].
313._ Les inventions exclues de la brevetabilité_ Elles sont tout d’abord visées aux sections 1(2), 1(3) et 4A du Patents Act 1977. La section 1(2) dispose :
« Ne constitue pas (notamment) une invention aux fins de la présente loi, tout ce qui consiste en :
a) une découverte, une théorie scientifique ou une méthode mathématique;[85]
b) une œuvres littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou toute autre création esthétique de quelque nature que ce soit ;
c) un plan, un principes ou une méthode dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques[86], ou un programme d’ordinateur;[87]
d) une présentation d’informations;[88]
toutefois, ces dispositions n’excluent qu’un élément soit considéré comme une invention aux fins de la présente loi que dans la mesure où un brevet ou une demande de brevet concerne un de ces éléments considéré en tant que tel. »
Les conditions générales d’application des exclusions visées à cette section 1(2) ont été précisées par la Cour d’Appel de Londres dans l’affaire Aerotel[89]. La Cour a proposé à cette occasion un test en quatre étapes. Selon ce test, le tribunal saisi doit:
- tout d’abord, interpréter correctement la revendication,
- ensuite, identifier la contribution du demandeur (à l’état de la technique),
- puis, se demander si la contribution est exclusivement couverte par la matière sujette à exclusion,
- et enfin, vérifier si la contribution réelle ou alléguée est bien de nature technique (une invention revendiquée dont l’unique contribution n’est pas de nature technique ou entre dans la catégorie des objets exclus devant être rejetée).
Cette approche, est différente de celle de l’OEB, qui a abandonné le critère de la contribution ou de l’effet technique dans le contexte des articles 52(2) et (3) de la CBE[90]. Cependant, la Cour d’appel a considéré que la pratique de l’OEB sur ce point n’était pas suffisamment fixée pour justifier l’abandon des précédents anglais sur ce point[91]. Le test Aerotel est donc celui appliqué par l’Intellectual Property Office dans la détermination des exclusions de la section 1(2).
La section 1(3) du Patents Act 1977 vise quant à elle « une invention dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre et à la moralité publics »[92]. La section 1(4) précise qu’une exploitation ne doit pas être considérée comme contraire à l’ordre et à la moralité publics du seul fait de son interdiction au Royaume-Uni. En conséquence, la simple illicéité ne justifie pas elle seule l’exclusion de la brevetabilité[93].
Enfin, la section 4A vise les méthodes de traitement et de diagnostic. Elle est rédigée depuis le 13 décembre 2007 comme suit :
« 4A.- (1) Un brevet ne peut être accordé pour une invention portant sur
a) une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ou
b) une méthode de diagnostic pratiqué sur le corps humain ou animal.
2) Le paragraphe (1) ci-dessus ne s’applique pas à une invention consistant dans une substance ou une composition destinée à être utilisée dans une telle méthode.
(3) Dans le cas d’une invention consistant en une substance ou une composition destinée à être utilisée dans une telle méthode, le fait que la substance ou la composition fasse partie de l’état de la technique n’empêche pas que l’invention soit considérée comme nouvelle si l’utilisation de la substance ou de la composition dans l’une de ces méthodes ne fait pas partie de l’état de la technique.
(4) Dans le cas d’une invention consistant en une substance ou une composition destinée à une utilisation spécifique dans une telle méthode, le fait que la substance ou la composition fasse partie de l’état de la technique n’empêche pas que l’invention soit considérée comme nouvelle si cette utilisation spécifique ne fait pas partie de l’état de la technique.»
Comme indiqué, les décisions des Chambres de recours de l’OEB ont valeur d’autorité et, dans la mesure où sa jurisprudence est fixée sur un point[94], seront généralement suivies par les tribunaux du Royaume-Uni.
314._ L’exclusion des programmes d’ordinateur: définition du « programme d’ordinateur »_ La question de la définition du « programme d’ordinateur » visé à la section 1(2) précitée a récemment fait l’objet d’une analyse poussée dans l’affaire Emotional Perception, qui a fait l’objet de deux décisions remarquées en 2023 et 2024[95], et dont il sera également question plus loin, à propos de l’effet technique du logiciel[96].
En l’espèce, l’invention litigieuse portait sur système amélioré de recommandations de fichiers multimédias (musicaux) à un utilisateur final, capable d’offrir des suggestions en faisant passer la musique par un réseau de neurones formé pour effectuer des catégorisations. La demande de brevet correspondante avait été rejetée par l’IPO, qui avait considéré que l’invention portait sur un programme d’ordinateur au sens de la section 1(2) du Patents Act 1977. Sur appel, par une décision remarquée de novembre 2003[97], la High Court avait jugé qu’une invention impliquant un réseau de neurones artificiels n’est pas un programme d’ordinateur en tant que tel, couvert par l’exclusion. Pour en arriver à cette conclusion, la High court avait distingué deux types de réseau de neurones envisageables pour des fonctions identiques : les réseaux purement physiques ou matériels, et les réseaux émulés au travers d’un logiciel. Pour la Cour, un réseau matériel ne constitue pas un logiciel, dans la mesure où n’implémente pas une série d’instructions prédéterminées par un humain, et fonctionne selon quelque chose qu’il a appris lui-même. Elle considérait alors que le même raisonnement devrait s’appliquer au réseau émulé, qui ne constitue dès lors pas un logiciel[98]. Elle jugeait que seul le programme qui réalise ou initie l’apprentissage de l’IA pouvait être considéré comme un logiciel[99], mais relevait que ce programme n’était pas revendiqué en tant que tel en l’espèce.
Ce jugement a été infirmé par la Cour d’appel de Londres, dans un arrêt du 19 juillet 2024 [100]. La Cour d’appel (Nicola Davies, Arnold and Birss LJJ) y revient en détail sur la définition des programmes d’ordinateur, et retient une définition centrée sur une série d’instructions destinées à un ordinateur[101], tout en écartant comme non pertinentes les critères complémentaires évoqués par la High Court[102]. Elle considère dès lors que le réseau de neurones, quelle que soit la façon dont il est mis en oeuvre, constitue bien un ordinateur, c’est à dire une machine pour traiter de l’information[103].
315._ Programmes d’ordinateur: portée de l’exclusion (l’effet technique)_ Les programmes d’ordinateur sont exclus lorsqu’ils sont revendiqués en tant que tels, le test de l’arrêt Aerotel[104] étant par ailleurs applicable aux inventions impliquant un logiciel. Dans l’affaire Halliburton Energy Services Inc’s Applications[105], la High Court a jugé qu’« un ordinateur programmé pour accomplir une tâche qui apporte une contribution à l’état de l’art d’une nature technique est une invention brevetable et peut être revendiquée comme telle »[106]. Ainsi le programme d’ordinateur qui réalise une contribution de cette nature n’est pas couvert par l’exclusion, car il constitue plus qu’un programme d’ordinateur. Cependant, l’association d’un programme d’ordinateur avec un matériel informatique standard, si elle permet d’échapper à l’exclusion liée à la revendication d’un programme d’ordinateur en tant que tel, ne permettra pas la brevetabilité de l’invention, dans la mesure où le matériel ne sera pas considéré comme un élément de la contribution.
La Cour d’appel de Londres a précisé la portée de brevetabilité des inventions logicielles dans l’arrêt Symbian[107]. En l’espèce, la demande décrivait une invention permettant d’éviter certains blocages dans le fonctionnement d’un ordinateur. Les revendications portaient sur une méthode et un logiciel destinés à la mettre en œuvre. L’Intellectual Property Office avait rejeté la demande au motif qu’elle portait sur un logiciel en tant que tel. La Cour d’appel de Londres rappelle que l’appréciation de la brevetabilité implique l’identification de la contribution technique afin de décider si elle consitute « l’objet exclu de la protection ». Elle considère qu’en l’espèce l’invention résout un problème technique concernant le fonctionnement interne d’un ordinateur, et qu’elle ne porte pas sur un programme d’ordinateur en tant que tel[108]. Dans l’affaire AT&T Knowledge Ventures/Cvon Innovations v Comptroller General of Patents[109], la High Court a synthétisé la jurisprudence dans ce domaine et dégagé des indices pour déterminer si le logiciel a apporté une contribution à l’état de la technique. Pour la Cour ils consistent à déterminer :
- si l’effet technique revendiqué a un effet technique sur un procédé mis en œuvre à l’extérieur de l’ordinateur ;
- si l’effet technique revendiqué est produit au niveau de l’architecture de l’ordinateur, c’est-à-dire s’il est produit indépendamment des données traitées ou des applications exécutées ;
- si l’effet technique revendiqué a pour effet de faire fonctionner l’ordinateur d’une façon nouvelle ;
- si l’ordinateur est plus rapide ou plus fiable ;
- ou si le problème perçu est résolu par l’invention revendiquée, et pas simplement contourné[110].
Dans l’affaire HTC v Apple[111], la Cour d’appel, tout en reconnaissant l’intérêt de ces indices, propose la synthèse suivante de sa jurisprudence :
« Dès lors, comment déterminer si une invention a réalisé une contribution à l’état de la technique ? (…) Premièrement, il n’est pas possible de definir une règle claire aux fins de déterminer si un programme est exclu ou non, et chaque affaire doit être traitée au cas par cas et conformément aux indications données par la Cour d’Appel dans les affaires Merrill Lynch et Gale et par les Chambres de recours dans les affaires [T 0208/84, T 06/83, et T 115/85].
Deuxièmement, Le fait que les améliorations soient apportées aux logiciels programmés dans l’ordinateur plutôt qu’au matériel informatique constituant l’ordinateur ne fait pas de différence. Comme je l’ai dit, l’analyse doit porter sur la substance non pas sur la forme (the analysis must be carried out as a matter of substance not form).
Troisèmement, les exclusions sont cumulatives (…).
Quatrièmement, il s’ensuit qu’il est utile de se demander ce que l’invention apporte réellement à l’état de la technique en termes pratiques, au-delà du fait qu’elle concerne un programme d’ordinateur. Si l’unique contribution consiste dans un objet exclu alors elle n’est pas brevetable.
Cinquièmement, et inversement, il est également utile de se demander si l’invention peut être considérée comme résolvant un problème essentiellement d’ordre technique, que ce problème se trouve à l’intérieur à l’extérieur de l’ordinateur. Une invention qui résout un problème technique à l’intérieur d’un ordinateur aura un effet technique pertinent en ce qu’elle rendra l’ordinateur, en tant qu’ordinateur, plus performant, par exemple en augmentant sa rapidité. Une invention qui résout un problème technique en dehors de l’ordinateur aura également un effet technique pertinent, par exemple si elle contrôle un processus technique amélioré. Dans les deux cas elle ne sera pas exclue comme portant sur un programme d’ordinateur en tant que tel aux termes de l’article 52 [de la CBE] »[112]
La jurisprudence offre plusieurs exemples d’inventions logicielles jugées non brevetables pour défaut d’effet technique[113].
316._ Application aux réseaux de neurones qualifiables de logiciels_ Dans l’affaire Emotional Perception précitée, la High Court avait pris soin d’examiner la question du critère de contribution technique appliquée à une invention revendiquant un logiciel utilisé pour l’apprentissage d’une IA. En l’espèce, la cour avait considéré que l’effet technique de l’invention allait au-delà du fonctionnement de l’ordinateur, et échapperait ainsi à l’exclusion[114]. La Cour d’appel s’est prononcée dans le sens contraire, en s’appuyant notamment sur la décision Yahoo de l’OEB[115], en jugeant qu’en l’espèce l’invention ne produit pas d’effet technique, en raison du caractère esthétique de la contribution[116].
317._ Invention d’IA: les lignes directrices de l’UKIPO_ L’UKIPO a publié en septembre 2022 des lignes directrices sur l’examen des demandes de brevet relatives à l’intelligence artificielle, modifiées en dernier lieu en mai 2024, qui donnent des indications sur l’application des exclusions du champ de la brevetabilité dans ce domaine, et examinent également brièvement l’exigence de suffisance de la divulgation de ces inventions[117]. Elles sont accompagnées de 18 exemples d’application (« scenarios »)[118]. Ces lignes directrices et exemples (en particulier les senarios 13 à 15 impliquant des réseaux de neurones) ont été par la suite modifiés pour prendre en compte la décision de la High Court dans l’affaire Emotional Perception précitée, qui s’imposait à UKIPO. Elles ont été suspendues temporairement dans l’attente de la décision d’appel dans ce dossier[119], rendue en mai 2024. Elles devraient donc être modifiées sur la question précise des inventions revendiquant des réseaux de neurones, en particulier dans les scénarios 13 à 15.
Les lignes directrices confirment tout d’abord la brevetabilité des inventions de l’IA dans tous les domaines technologiques. Elles précisent ensuite que si ces inventions sont des inventions mises en œuvre par ordinateur, qui reposent sur des méthodes mathématiques et des programmes informatiques, les exclusions correspondantes sont appliquées en considération, non pas de la forme, mais de la substance de l’invention, au regard des tâches ou processus qu’elle exécute. Ainsi, lorsque la tâche ou le processus exécuté par une invention d’IA apporte une contribution technique à l’état de la technique connu, l’invention n’est pas exclue et est brevetable. Les lignes directrices précisent qu’une invention d’IA apporte une contribution technique si :
- elle incarne ou exécute un processus technique qui existe indépendamment d’un ordinateur, ou
- elle contribue à résoudre un problème technique extérieur à un ordinateur ou interne de l’ordinateur lui-même, ou
- s’il s’agit d’une nouvelle façon d’exploiter un ordinateur au sens technique du terme.
A l’inverse, une invention d’IA n’apporte pas de contribution technique si :
- elle se rapporte uniquement à des éléments exclus (par exemple une méthode commerciale), sans y ajouter,
- elle se rapporte uniquement au traitement ou à la manipulation d’informations ou de données, sans y ajouter, ou si
- elle consiste simplement un programme optimisé ou mieux écrit pour un ordinateur conventionnel, sans y ajouter.
L’UKIPO précise que ces conditions s’appliquent aux inventions relevant de l’« IA appliquée » ou de l’« IA de base », et s’appliquent également l’entraînement des inventions d’IA. L’Office ajoute que la protection par brevet est possible pour les ensembles de données d’entraînement lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’une invention apportant une contribution technique, mais rappelle que les revendications portant sur des ensembles de données caractérisés uniquement par leur contenu informatif sont exclues en tant que présentation d’informations en tant que telles.
Comme indiqué, la position concernant les réseaux de neurones issue du jugement de la High Court dans l’affaire Emotional Perception, notamment traduite dans les exemples (scenarios) 13 à 15 du guide (respectivement: optimising a neural network; avoiding unnecessary processing using a neural network; active training of a neural network), et allant dans le sens de la non-application de l’exclusion, devrait être modifiée à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel dans ce dossier.
Enfin, l’UKIPO indique que la suffisance de la divulgation d’une invention d’IA ou d’un ensemble de données s’apprécie de la même façon que pour toute autre invention[120].
318._ Les inventions dans le domaine du vivant et des biotechnologies_ Les Patent Regulations 2000 ont transposé les articles 1 à 11 de la directive 98/44/CE sur les inventions dans le domaine de la biotechnologie. Leur régime est inscrit à la section 76A et à l’Annexe A2 du Patents Act (biotechniological inventions). La section 76A dispose:
« (1) Les dispositions de la présente loi, ainsi que les dispositions prises en application de la loi, s’appliquent à un brevet ou à une demande de brevet portant sur une invention biotechnologique, sous réserve des dispositions de l’Annexe A2.
(2) Rien dans la présente section ou dans l’Annexe A2 ne peut être interprété comme affectant l’application d’une disposition en relation avec une autre forme de brevet ou demande de brevet. »
L’Annexe A2 reprend les dispositions de la directive 98/44/CE. Elle précise tout d’abord que la brevetabilité d’une invention ne peut être refusée au seul motif qu’elle porte sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique[121]. Elle ajoute qu’une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique peut être l’objet d’une invention, même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel[122].
Les exclusions de la brevetabilité sont visées au paragraphe 3 de l’Annexe. Aux termes de ce paragraphe, ne sont pas brevetables:
- le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables;
- les procédés de clonage des êtres humains;
- les procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain;
- les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;
- les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.
- Et les variétés végétales et les races animales et les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention de végétaux ou d’animaux, qui ne sont pas des procédés microbiologiques, ou d’autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.
Les définitions du « procédé microbiologique », d’un « procédé essentiellement biologique » et de la variété végétale, conformes à la directive (et règlement CE n°2100/94 pour la variété végétale) sont inscrites au paragraphe 11 de l’Annexe[123]. Les paragraphes 4 à 5 transposent les précisions de la directive sur la portée des exclusions :
« 4. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.
5. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel. »
Le paragraphe 6 ajoute que l’application industrielle d’une séquence ou d’une séquence partielle d’un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet.
Quant aux règles de la directive concernant la portée de la protection, elles sont transposées aux paragraphes 7 à 10 de l’annexe, comme suit :
« 7. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.
8. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.
9. La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s’étend à toute matière, sous réserve du paragraphe 3(a) ci-dessus, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction.
10. La protection conférée aux paragraphes 7, 8 et 9 ci-dessus ne s’étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d’une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d’un État membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l’utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d’autres reproductions ou multiplications. »
Enfin, les exceptions relatives à la reproduction des animaux et à l’utilisation de matériels de reproduction par les fermiers prévues par la directive 98/44/CE ont été introduites par les Patents Regulations 2000[124].
S’agissant des décisions de la CJUE antérieures à la fin de la période de transition adoptées dans ce domaine[125], on rappellera que le Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023 a modifié les règles relatives à leur autorité[126]. Ces arrêts s’imposent toujours aux tribunaux à l’exception de la Cour suprême et de la Cour d’appel, mais la loi prévoit désormais une liste non exhaustive de facteurs que les tribunaux doivent prendre en compte pour décider de diverger de cette jurisprudence retenue, incluant notamment tout changement de circonstances pertinent, et le risque de « restriction au développement adéquat de la loi domestique » (« whether the assimilated EU case law restricts the proper development of domestic law »). Enfin, le Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023 a introduit deux nouvelles sections dans le European Union (Withdrawal) Act 2018, qui mettent en place un mécanisme permettant aux tribunaux de soumettre des questions importantes relatives à la « jurisprudence assimilée de l’EU » à la Cour d’appel. Ces modifications pourront entraîner un ajustement de la jurisprudence dans notre domaine. On notera cependant qu’en application des textes antérieurs au Retained EU Law (Revocation and Reform) Act, la Cour d’appel de Londres (qui n’était déjà plus liée par les précédents européens) avait a clairement indiqués qu’elle n’avait pas l’intention de s’écarter de la jurisprudence de la CJUE, notamment pour des raisons de sécurité juridique[127].
Les décisions de l’OEB ont quant à elles valeur d’autorité dans les conditions déjà décrites[128],
319._ La nouveauté et les divulgations non opposables_ La nouveauté est définie dans la section 2 du Patents Act, qui précise également les divulgations non opposables, conformément au texte des articles 54 et 55 de la CBE. S’agissant de la définition de la nouveauté, le texte dispose :
« 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
2) S’agissant d’une invention, l’état de la technique comprend tout élément (produit, procédé, information relative au produit ou au procédé, ou toute autre chose) qui a été rendu accessible au public (au Royaume-Uni ou ailleurs) par une description écrite ou orale, une utilisation ou tout autre moyen, à une date antérieure à la date de priorité de l’invention.
3) Dans le cas d’une invention à laquelle une demande de brevet ou un brevet se rapporte, l’état de la technique comprend également les éléments contenus dans d’autres demandes de brevet qui ont été publiées à la date de priorité de l’invention mentionnée en premier lieu ou après cette date, si les conditions suivantes sont remplies, à savoir:
a) ces éléments figuraient dans ladite demande de brevet telle qu’elle a été déposée et publiée;
b) la date de priorité de ces éléments est antérieure à celle de l’invention. »
Ainsi, l’État de la technique comprend (1) tous les éléments mis à la disposition du public par une description écrite ou orale, une utilisation ou tout autre moyen avant la date de dépôt (date de priorité) et (2) le contenu des demandes de brevet du Royaume-Uni, de demandes de brevet européennes (Royaume-Uni) et internationales désignant le Royaume-Uni entrées dans la phase nationale ou régionale, et portant une date de dépôt antérieure (date de priorité) publiées à cette date ou après. Comme en droit français, la totalité du contenu des demandes est réputée faire partie de l’état de la technique (whole content approach)[129].
Dans l’affaire SmithKline Beecham Plc’s (Paroxetine Methanesulfonate) Patent[130], la Chambre des Lords a précisé que l’antériorité opposable devait satisfaire à deux conditions : une divulgation préalable (qui aboutirait en principe à une contrefaçon du brevet), d’une part, et la possibilité d’une mise en œuvre de l’invention (identique à l’exigence posée en matière de dépôt), d’autre part.
Les divulgations non opposables sont définies aux points 4 et 5, et sont similaires à celles prévues en droit français. La divulgation n’est pas prise en compte pour déterminer la nouveauté si elle a eu lieu au cours des six mois qui précèdent la date de dépôt en raison (a) d’éléments directement ou indirectement obtenus d’une manière illicite de l’inventeur ou par suite de la violation d’une obligation de confidentialité ou (b) de la présentation de l’invention par l’inventeur à une exposition internationale[131].
Aucun délai de grâce général similaire à celui institué aux États-Unis n’est prévu.
320._ Premier usage médical d’une substance connue et seconde application thérapeutique _ La section 4(A)(3) du Patents Act dispose :
« Dans le cas d’une invention consistant en substance ou d’une composition destinée à être utilisée dans une telle méthode [de traitement chirurgical ou thérapeutique ou de diagnostic], le fait que la substance ou la composition fait partie de l’état de l’art n’empêchera pas l’invention d’être nouvelle si l’utilisation de la substance ou de la composition dans une telle méthode ne fait pas partie de l’état de l’art. »
Dans cette hypothèse, il est possible d’obtenir un brevet pour l’utilisation de la substance ou composition en traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic. La seconde application thérapeutique est également brevetable dans les conditions posées par la section 4(A)(4), qui dispose :
« Dans le cas d’une invention se composant d’une substance ou d’une composition pour un usage spécifique dans une telle méthode, le fait que la substance ou la composition fait partie de l’état de l’art n’empêchera pas l’invention d’être nouvelle si cette utilisation spécifique ne fait pas partie de l’état de l’art. »
Ces règles n’affectent pas l’exigence d’activité inventive. Ainsi, si l’utilisation de la même substance sous un nouveau dosage pour traiter la même maladie peut constituer un usage nouveau[132], l’activité inventive fera défaut, dans la mesure où la recherche du dosage optimal est une pratique normale[133]. L’effet thérapeutique revendiqué doit également être démontré[134].
321._ L’activité inventive (inventive step)_ La section 3 du Patents Act 1977 reprend sur ce point le texte de l’article 54 de la Convention sur le brevet européen, et dispose:
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente d’un élément faisant partie de l’état de la technique en vertu uniquement de l’article 2.2 (et abstraction faite de l’article 2.3) ».
L’interprétation de cette disposition ne semble pas ici différer, du moins dans ses principes, des solutions européennes et françaises[135]. Le test d’obviousness, initalement résumé par la Cour d’appel de Londres dans son arrêt Windsurfing International (rendu sur la base du Patents Act 1949)[136], a été reformulé par cette dernière en 2007 dans l’arrêt Pozzoli[137]. Pour la Cour, le test impose:
« 1) a) d’identifier l’« homme de l’art » (« person skilled in the art »)
b) d’identifier les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne ;
2) d’identifier le concept inventif de la revendication en question ou, s’il n’est pas facile de le faire, l’interpréter ;
3) d’identifier les différences, le cas échéant, entre l’élément cité comme faisant partie de l’« état de la technique » et le concept inventif de la revendication ou de la revendication telle qu’interprétée;
4) et de déterminer si, considérées sans aucune connaissance de l’invention alléguée telle que revendiquée, ces différences constituent des étapes qui auraient été évidentes pour l’homme du métier ou si elles nécessitent un certain degré d’inventivité »[138].
Nous renvoyons pour le surplus aux développements du Manual of Patent Practice, s’agissant notamment de la détermination de l’homme de l’art (skilled person) et de ses connaissances[139], et des questions portant sur l’état de la technique (étant précisé sur ce dernier point, que conformément aux principes européens, il est bien évidemment possible de combiner différents éléments de l’état de la technique dans la détermination de l’activité inventive)[140].
322._ L’application industrielle_ Aux termes de la section 4 du Patents Act, qui reprend l’article 57 de la Convention CBE, « une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture ». Le terme industrie est également compris dans un sens large[141]. La question de l’application industrielle d’un gêne a fait l’objet d’une appréciation par la Cour Suprême en 2011 dans l’affaire Human Genome Sciences v Eli Lilly[142], qui renvoie sur ce point à l’approche adoptée par la Chambre de recours technique de l’OEB[143].
B. Les conditions de forme
323._ Les registered patent attorneys_ Aux Royaume-Uni toute personne peut en représenter une autre dans les formalités liées au dépôt d’un brevet. Cependant, seul un registered pattent attorney peut utiliser l’appellation patent agent ou patent attorney[144]. Le régime général de la profession est inscrit au CDPA 1988. Le Patent Attorney, personne physique ou morale, peut, dans les limites et conditions prévues par la loi, faire profession d’agent aux fins de déposer les demandes de brevets et de conduire les procédures applicables devant le Contrôleur[145]. Les Chartered patent agents peuvent également plaider devant l’Intellectual Property Entreprise Court (IPEC), qui remplace les Patents County Court[146]. L’organisme professionnel des registered pattent attorneys est le Chartered Institute of Patent Attorneys.
Les relations entre les patents attorneys et leurs clients sont soumises à des règles de confidentialité similaires à celles applicables aux relations entre les solicitors et leurs clients[147].
324._ L’Intellectual Property Office et le Comptroller of Patents_ Faisant suite à une recommandation du Rapport Gowers de 2006[148], l’ancien Patent Office a pris le nom d’Intellectual Property Office le 2 avril 2007. L’office est une agence du Department for Business, Innovation and Skills. Il est dirigé par le Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (ci-après le « Contrôleur »).
325._ La demande_ Aux termes de la section 7(1) du Patents Act, toute personne peut déposer une demande de brevet, soit individuellement, soit conjointement avec une autre personne. La demande de brevet doit contenir (a) une demande de délivrance d’un brevet, (b) des spécifications (specifications) contenant une description de l’invention (description), une ou des revendications (claims) et tout dessin visés dans la description ou dans une revendication (drawings); et (c) un abrégé (abstract)[149].
Les spécifications doivent exposer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse la réaliser[150]. Les revendications doivent (a) définir l’objet de la protection (b) être claires et précises (c) être soutenues par la description et (d) se rapporter à une invention ou à un groupe d’inventions qui sont liées de manière à former un concept inventif unique[151]. L’abrégé fournit l’information technique essentielle sous forme résumée[152].
Une demande de brevet peut être retirée à tout moment avant délivrance du brevet[153].
Les demandes divisionnaires sont possibles. En revanche, et contrairement aux États-Unis, la loi ne permet pas les demandes de continuations partielles (continuation in part)[154].
D’un point de vue pratique, l’UKIPO a mis en place depuis 2021 des procédures de simplification des dépôts et d’accélération des procédures, au travers du One IPO Transformation Programme qui a vocation à fournir un service unique et intégré pour la gestion de tous les droits de propriété intellectuelle du Royaume-Uni[155].
326._ L’examen et la délivrance du brevet_ Une fois la demande déposée, un examen de la régularité formelle du dépôt et paiement des redevances applicable est réalisé. La demande est alors transmise à un examinateur pour un examen préliminaire (preliminary examination) des conditions de brevetabilité[156]. Cet examen donne lieu à un rapport, communiqué au demandeur (en pratique dans un délai de quatre à six mois à compter du dépôt). Celui-ci peut formuler des observations et dans certains cas modifier ses revendications (sans les étendre cependant à un élément non visé dans les spécifications). Il peut également retirer sa demande.
Si l’examen préliminaire est satisfait, la demande est publiée avec le rapport de recherche et, le cas échéant, les revendications modifiées[157]. Cette publication doit avoir lieu au plus tôt après l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de dépôt ou la date de priorité, selon le cas (et sauf retrait ou retrait de la demande antérieur) [158]. La publication peut avoir lieu plus tôt sur demande du déposant. Si le brevet est en état d’être délivré avant l’expiration des dix-huit mois, la délivrance est repoussée d’au moins mois à compter de la publication, afin de permettre aux tiers de formuler des observations[159]. Comme indiqué la demande est publiée avec le rapport de recherche, généralement délivré bien avant l’expiration du délai de publication.
Une phase d’examen (substantive examination) commence à publication de la demande[160], qui donne lieu au dépôt d’un nouveau formulaire et au paiement d’une seconde redevance. L’examen doit être demandé dans les six mois du dépôt. L’examen porte sur l’ensemble des conditions de brevetabilité. Les spécifications et les revendications peuvent être modifiées pour répondre aux remarques de l’examinateur. En l’absence d’objections ou si celles-ci sont satisfaites, le brevet est publié.
Afin d’accélérer l’examen, l’Intellectual Property Office a mis en place depuis 1995 une procédure plus rapide de recherche et d’examen combinée (combined search and examination procedure), qui intervient lorsque la demande d’examen est formée au moment du dépôt.
Une voie rapide (et gratuite) pour les inventions apportant un bénéfice écologique (green channel) a également été instituée en 2009. Ce service permet aux demandeurs de formuler par écrit une demande de traitement accéléré de leur demande de brevet si l’invention présente un avantage environnemental. Le demandeur doit décrire cet avantage (qui ne fait pas l’objet d’une enquête), et préciser quel stade de la procédure il souhaite accélérer (recherche, examen, recherche et examen combinés, et/ou publication). Ces traitements accélérés peuvent également être accordés pour les autres types d’inventions, mais sur justification (l’UKIPO donne l’exemple de la connaissance d’un contrefacteur potentiel, ou du besoin de sécuriser un investisseur). L’IPO maintient une base de données des demandes éligibles au green channel traitées selon cette procédure[161].
Ces procédures accélérées sont également applicables aux demandes PCT[162], et l’Intellectual Property Office participe à l’initative Patent prosecution highway et au programme Global patent prosecution highway d’accélération du traitement des demandes de brevet déjà examinées par un des offices étrangers partenaire[163].
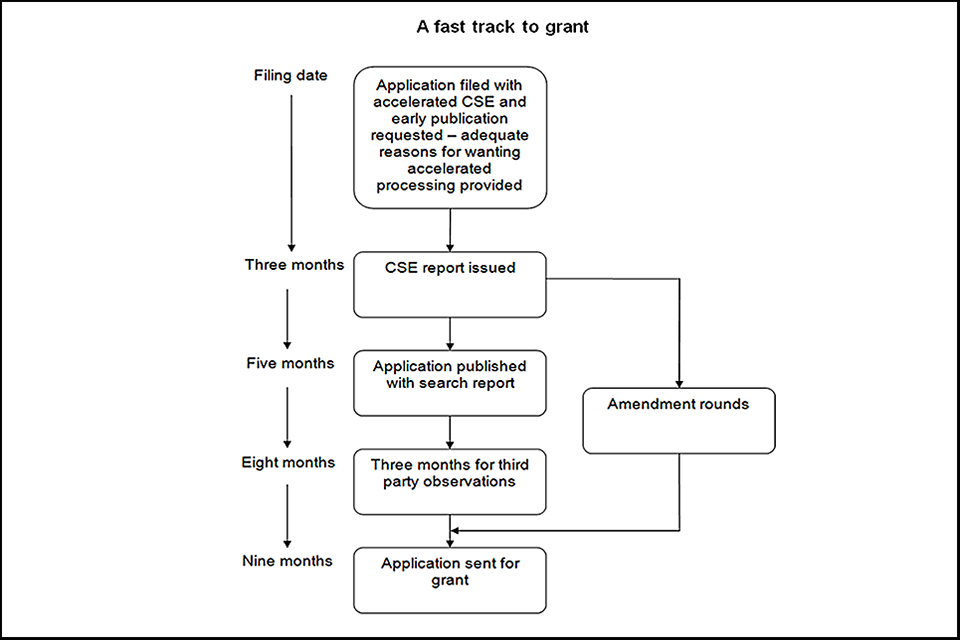
Exemple de calendrier accéléré (fast-track)[164]
3. La propriété et l’exploitation de l’invention
A. La titularité du brevet
327._ Le droit au brevet_ Aux termes de la section 7(2) du Patents Act, le droit au brevet appartient en principe à l’inventeur ou aux coinventeurs et leur ayant cause[165]. L’inventeur est la personne physique qui a conçu l’invention[166]. Comme nous l’avons vu, ces règles ont récemment été précisées dans le contexte des inventions générées par IA, en dernier lieu par la Cour suprême dans son arrêt Thaler v. Comptroller[167]. La Cour y confirme que l’inventeur au sens du Patents Act 1977, et notamment de ses articles 7 (droit au dépôt) et 13 (mention de l’inventeur), est nécessairement une personne physique, et que le Patents Act 1977 ne donne pas le droit à une personne d’obtenir un brevet pour un produit ou procédé créé de manière autonome par une machine, notamment sur le fondement de son droit de propriété sur la machine[168].
La loi établit également une présomption réfragable de titularité en faveur du déposant[169].
Les litiges relatifs au droit au brevet (antérieurs et postérieurs à la délivrance) peuvent être soumis au Contrôleur[170], qui peut décliner sa compétence au profit du tribunal.
328._ Les inventions de salariés_ Au Royaume-Uni, l’invention réalisée par un salarié appartient à l’employeur si elle a été réalisée à l’occasion de l’exercice de ses fonctions habituelles ou à l’occasion d’une mission exceptionnelle en dehors de ses fonctions habituelles et qui lui aurait été spécialement confiée, pourvu qu’une invention puisse avoir été raisonnablement espérée de cette mission[171].
Cette catégorie correspond plus ou moins à nos inventions de mission. Elle est étendue aux inventions créées par des salariés ayant pour mission de servir les intérêts de leur entreprise, c’est-à-dire les dirigeants et membres des conseils d’administration. Les autres inventions appartiennent au salarié[172]. A noter que la loi prévoit une compensation du salarié si l’invention et le brevet qui en découlent profitent de manière exceptionnelle à l’employeur.[173] La jurisprudence sur type de rémunération est très rare[174].
329._ Le droit moral de l’inventeur_ Au termes de la section 13 du Patents Act 1977, l’inventeur ou les coinventeurs ont le droit d’être mentionnés comme tels dans tous les brevets accordés pour l’invention, et auront également le droit d’être mentionnés, si possible, dans toute demande publiée de brevet pour l’invention. L’inventeur peut renoncer à son droit d’être identifié (ou demander à ce que son adresse soit supprimée)[175], mais doit justifier des raisons de cette renonciation (sauf concernant le retrait de son adresse) auprès du Contrôleur[176].
330._ Propriété et copropriété du brevet_ Le Patents Act 1977 utilise le terme proprietor pour désigner le titulaire du brevet. La section 30 dispose qu’un brevet ou une demande de brevet est une propriété mobilière (personal property)[177]. Tout brevet ou toute demande de brevet on peut être cédé, concédé, ou faire l’objet de sûretés[178].
Le propriétaire du brevet peut également à tout moment renoncer à son brevet par notification adressée au Contrôleur[179]. Une opposition à cette renonciation peut être formée devant le Contrôleur[180]. Si Contrôleur considère que le brevet peut être abandonné, il peut accepter la demande, et le brevet cesse d’avoir effet au jour de la publication de son acceptation au bulletin des brevets[181]. Dans ce cas aucune action en contrefaçon ne peut être formée ou subsister pour tout acte antérieur à cette date[182].
Lorsqu’un brevet est accordé à deux personnes ou plus, chacune d’elle a droit, sauf accord contraire, à une quote-part égale du brevet[183]. Sauf accord contraire, chacun des copropriétaires peut exploiter le brevet, pour son propre avantage, sans le consentement de l’autre ou des autres copropriétaires et sans avoir à lui ou leur rendre compte[184]. Par ailleurs, sauf accord contraire, un copropriétaire ne peut, sans le consentement des autres copropriétaires (a) modifier les spécifications du brevet ou demander une telle modification ou demander la radiation du brevet, ou (b) accorder une licence du brevet ou céder ou constituer un nantissement du brevet ou d’une partie du brevet[185].
La loi prévoit également que lorsqu’un produit breveté est vendu ou transféré par l’un des copropriétaires, le cessionnaire peut exploiter le produit comme s’il lui avait été vendu ou transféré par le titulaire unique du brevet[186].
B. L’étendue de la protection
331._ Les droits exclusifs du breveté_ Ces droits, présentés de manière négative (restricted acts), sont définis à la section 60(1) à (3) du Patents Act. La section 60(1) correspond aux actes de contrefaçon primaire. Elle dispose :
« 60.- (1) sous réserve des dispositions de cette section, une personne contrefait un brevet portant sur une invention si, mais seulement si, alors que le brevet est en vigueur, il accomplit l’un des actes suivants au Royaume-Uni par rapport à l’invention sans consentement du propriétaire du brevet, c’est-à-dire :
(a) lorsque l’invention est un produit, il fabrique[187], distribue (disposes of)[188], offre de distribuer, utilise ou importe le produit ou le détient[189] en vue d’une distribution ou autrement ;
(b) lorsque l’invention est un procédé, il utilise le procédé[190] ou propose de l’utiliser au Royaume-Uni quand il sait, ou quand il apparaît évident à une personne raisonnable dans les circonstances, que son utilisation sans consentement du propriétaire serait une contrefaçon du brevet ;
(c) lorsque l’invention est un procédé, il distribue (disposes of), offre à la distribution, utilise ou importe tout produit obtenu directement au moyen du procédé ou détient un tel produit en vue de la distribution ou autrement ».
Les sections 60(2) et 60(3) visent les actes de contrefaçon secondaire (indirect use of the invention, contributory infringement). Elles disposent :
« (2) sous réserve des conditions suivantes, une personne (autre que le propriétaire du brevet) contrefait également un brevet pour une invention si, alors que le brevet est en vigueur et sans consentement du propriétaire, il fournit ou offre à l’approvisionnement au Royaume-Uni à une personne autre qu’un titulaire d’une licence ou toute autre personne autorisée à travailler l’invention, un des moyens concernant un élément essentiel de l’invention, permettant de mettre en œuvre l’invention, quand il sait, ou qu’il apparaît évident à une personne raisonnable dans ces circonstances, que ces moyens permettent et ont pour objet de mettre en œuvre l’invention au Royaume-Uni.
(3) le paragraphe (2) ci-dessus ne s’appliquera pas à l’approvisionnement ou à l’offre d’un produit commercial de base à moins que l’approvisionnement ou la proposition soit fait afin d’inciter la personne fournie ou, selon les circonstances, la personne à qui la proposition est faite, à commettre un acte constitutif d’une contrefaçon du brevet aux termes du paragraphe (1) ci-dessus. »
L’élément intentionnel est toujours requis pour les actes de contrefaçon secondaires.
332._ Les exceptions_ Les exceptions sont définies aux sections 60(5). Les sections 60(6) à 60(6G) apportent des précisions sur l’application ou l’interprétation de ces exceptions. La liste vise:
- Les actes accomplis à titre privé à des fins non commerciales.
- Les actes accomplis à des fins expérimentales[191].
- La préparation extemporanée dans une pharmacie d’un médicament sur ordonnance et sa vente subséquente ;
- Certaines utilisations à bord de navires, d’aéronefs, d’aéroglisseurs ou de véhicules étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire national.
- l’utilisation par un agriculteur du produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même sur sa propre exploitation, en cas de vente ou d’autre forme de commercialisation à des fins d’exploitation agricole de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet ou avec son consentement, dans les conditions et selon les modalités (notamment rémunération équitable sauf pour les petites exploitations) prévues par l’article 14 du Règlement 2100/94 sur les obtentions végétales (exception prévue à l’article 11 de la directive 98/44/CE)[192].
- L’utilisation par les éleveurs d’animaux reproducteurs ou d’autre matériel de reproduction animale pour leur propre activité, mais pas pour la vente ou à des fins de reproduction commerciale (exception prévue à l’article 11 de la directive 98/44/CE).
- Les tests et essais relatifs à des produits vétérinaires ou médicaux, visant à démontrer qu’un produit générique est équivalent à un produit breveté approuvé, pour obtenir une autorisation de commercialisation.
- L’utilisation d’un produit lors de la réalisation des évaluations de produits médicinaux, pour fournir des informations nécessaires à l’autorité de réglementation ou pour l’évaluation des technologies de la santé.
Il faut ajouter à cette liste l’épuisement des droits, l’exception de possession personnelle antérieure, certaines exploitations par l’État et les licences obligatoires, dont il sera question ci-après.
A noter enfin qu’en matière de réparation la jurisprudence confère le plus souvent un droit de réparation à l’acheteur légitime du produit breveté au travers d’une licence tacite[193].
333._ L’épuisement interne_ A l’origine, l’épuisement des droits au Royaume-Uni a pris la forme de licences tacites (épuisement facultatif). Ce système fonde la liberté du distributeur ou de l’utilisateur du produit licitement mis sur le marché sur la présence d’une licence (ou autorisation) tacite concédée par le titulaire des droits: si l’acheteur peut utiliser ou revendre librement l’objet acheté, c’est qu’il en a tacitement reçu l’autorisation. L’épuisement suppose donc l’existence préalable de pouvoirs sur la commercialisation et l’utilisation du produit licitement fabriqué[194]. Ce qui est le cas du brevet anglais, qui a toujours conféré à son titulaire le droit exclusif « de fabriquer, d’utiliser, de mettre en œuvre et de vendre l’invention »[195]. Comme l’a relevé la Chambre des Lords, « l’application littérale de ces dispositions entraînerait cette conséquence absurde que l’acheteur du produit breveté commettrait une contrefaçon en l’utilisant ou en le revendant »[196]. D’où la nécessité de trouver une technique qui permette de libérer l’utilisateur :
« Si le titulaire du brevet vend l’objet breveté et si l’acheteur l’utilise, ce dernier ne commet naturellement pas de contrefaçon. Mais pour quelle raison? En raison du fait que le droit résultant de la vente implique une licence tacite concédée par le titulaire à l’acheteur pour que celui-ci puisse se servir de ce qu’il a acheté; et à défaut de toute condition particulière, cette licence tacite est une licence qui permet à l’acheteur d’utiliser le produit à son gré, de le vendre ou de le commercialiser »[197].
Comme indiqué, la jurisprudence confère également le plus souvent un droit de réparation à l’acheteur légitime du produit breveté au travers d’une licence tacite[198], mais la réparation (ou la modification) ne doit pas aboutir à une reconstruction (à la réalisation de l’invention)[199].
334._ L’épuisement communautaire et international_ Le Patents Act 1977 ne contient aucune disposition sur les importations parallèles[200].
Comme nous l’avons vu[201], les textes issus du Brexit prévoient que les droits de propriété intellectuelle qui ont été épuisés tant dans l’Union qu’au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les conditions prévues par le droit de l’Union restent épuisés[202]. En revanche, l’accord de sortie, comme l’accord de commerce UE/RU et les textes internes d’application ne prévoient pas de règle pour les droits épuisés après le 1er janvier 2021. Les Exhaustion of Rights (EU Exit) Regulations 2019[203] ont modifié les textes en matière d’épuisement des droits de copyright, de dessins et modèles et de marques, pour préserver les principes d’épuisement préexistant applicables à l’Espace économique européen, mais ne contiennent pas de dispositions équivalentes en matière de brevets. Cependant, par exception aux principes posés par le Retained EU Law (Révocation and Reform) Act 2023, les Intellectual Property (Exhaustion of Rights) (Amendment) Regulations 2023 ont modifié le Patents Act 1977, de manière à maintenir, s’agissant de la définition de l’épuisement, le « EU retained right » au-delà du 1er janvier 2024[204]. Ce maintien est sans préjudice de la possibilité laissée au Gouvernement de modifier ce régime à l’avenir.
Ces précisions faites, la jurisprudence européenne en matière d’épuisement communautaire des droits du breveté est certes applicable, mais dans la mesure où, en matière de brevet, aucune prohibition de l’épuisement international n’est imposée par le droit de l’Union européenne, le Royaume-Uni a, sur ce point maintenu sa jurisprudence fondée sur un mécanisme de licences tacites. Ainsi, la vente d’un produit en dehors de l’EEE sans restriction emporte en principe une licence tacite autorisant sa revente au Royaume-Uni[205], sauf en cas de modification ou réparation emportant reconstruction. Les restrictions ne font obstacle à l’importation que si le défendeur en a eu connaissance[206].
335._ Le droit de possession personnelle antérieure_ Le Patents Act 1977 contient une exception correspondant au droit de possession personnelle antérieure, qui repose, non pas sur la possession, mais sur l’exploitation ou des préparatifs d’exploitation. Ces actes sont en outre définis de manière assez stricte. La section 64 du Patents Act 1977 dispose:
« 64.—1) Après la délivrance d’un brevet pour une invention, une personne qui, au Royaume-Uni, avant la date de priorité de l’invention,
a) accomplit de bonne foi un acte qui constituerait une contrefaçon du brevet s’il était en vigueur ou
b) fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue d’accomplir un tel acte
a le droit de poursuivre l’accomplissement de l’acte ou, selon le cas, d’accomplir l’acte nonobstant la délivrance du brevet, mais ce droit ne s’étend pas à la concession à un tiers d’une licence pour accomplir cet acte.
2) Si l’acte a été accompli ou si les préparatifs ont été faits dans le cours d’une transaction commerciale, la personne qui bénéficie du droit conféré par l’alinéa 1) peut
a) autoriser l’un de ses associés au moment considéré dans la transaction commerciale à accomplir cet acte et
b) céder ce droit ou le transmettre pour cause de mort (ou, s’agissant d’une personne morale, à sa dissolution) à toute personne qui acquiert la part de la transaction commerciale au cours de laquelle l’acte a été accompli ou les préparatifs ont été faits.
3) Lorsqu’un produit a été cédé à un tiers dans l’exercice des droits conférés par l’alinéa 1) ou 2), ce tiers et toute personne se réclamant de lui peuvent user du produit de la même manière que s’il avait été cédé par le titulaire du brevet. »
L’usage antérieur doit ainsi correspondre à « des actes qui seraient constitutifs de contrefaçon » ou à des « préparatifs effectifs et sérieux » en vue de la réalisation de ces actes[207]. L’exception ne distingue pas entre usage privé et public. Bien évidemment, le caractère public de l’acte peut détruire la nouveauté du brevet postérieur. Les actes d’exploitation ou de préparation doivent avoir été effectués au Royaume-Uni. L’exception n’est pas strictement limitée aux actes effectués avant la date de priorité, et permet l’accomplissement d’actes substantiellement similaires[208]. Elle ne permet cependant pas de fabriquer un produit dans le champ du brevet[209].
336._ Exploitations d’une invention par l’État (Crown use)_ Les sections 55 à 59 du Patents Act 1977 réglementent les droits accordés à la Couronne sur les inventions brevetées. La section 55 permet aux services du gouvernement et aux personnes autorisées et toute personne autorisée par écrit par un ministère d’accomplir, pour les services de la Couronne, et au Royaume-Uni, les actes suivants à l’égard d’une invention brevetée sans le consentement du propriétaire du brevet :
- s’agissant d’un produit, i) fabriquer, utiliser, importer ou détenir le produit, ou le vendre ou l’offrir en vente lorsqu’un tel acte découle de sa fabrication, son usage, son importation ou sa détention ou y est accessoire; et ii) en tout état de cause, le vendre ou l’offrir en vente à des fins de défense d’un pays étranger ou pour la production ou la fourniture de produits pharmaceutiques ou médicinaux déterminés (autrement que par la vente) à une fin quelconque;
- s’agissant d’un procédé, l’utiliser ou accomplir à l’égard de tout produit obtenu directement par ce procédé tous les actes mentionnés au paragraphe précédent;
- lorsque l’invention ou un produit obtenu directement par l’invention consiste en un produit pharmaceutique ou médicinal déterminé, le vendre ou l’offrir en vente;
- livrer ou offrir de livrer à toute personne l’un quelconque des moyens de mise en œuvre de l’invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci ;
- disposer ou offrir de disposer de tout objet fabriqué, utilisé, importé ou détenu dans l’exercice des droits conférés et qui n’est plus exigé dans le but pour lequel il a été fabriqué, utilisé, importé ou détenu, selon le cas.
Ces droits de la Couronne sont substantiellement renforcés pendant les périodes d’urgence[210]. Une compensation monétaire est prévue[211]. La section 57 précise les effets des droits de la Couronne sur les cessionnaires et licenciés[212]. Les litiges concernant un usage par la Couronne sont soumis aux tribunaux[213].
337._ La durée des droits_ Sous l’empire du Patents Act 1949, la durée maximum des brevets était de 16 ans. Le Patents Act 1977 a étendu cette durée à 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande[214].
Les certificats complémentaires de protection (supplementary protection certificates) institués par les Règlements 1768/92 et 1610/96 en faveur, respectivement, des médicaments et des produits phytopharmaceutiques, permettent d’étendre la durée de protection des brevets concernés à vingt-cinq ans au maximum[215]. L’extension de six mois prévue par le Règlement 1901/2006/CE relatif aux médicaments à usage pédiatrique est également toujours applicable.
C. L’exploitation du brevet
338._ Les contrats_ Les brevets et demandes de brevet sont des biens mobiliers (personal properties) [216]. Les brevets et demandes de brevet, ainsi que les droits sur des brevets ou demandes de brevet et les droits découlant de brevets et de demandes de brevet peuvent être transmis, cédés, faire l’objet de nantissements ou concédés en licence[217]. Des sous-licences peuvent être concédées dans la mesure où la licence le prévoit[218]. Les licences et sous-licences peuvent être cédées ou nanties[219].
Les cessions, nantissements ou consentements relatifs à un brevet doivent être établis par écrit et signés par ou au nom du cédant ou constituant, à peine de nullité[220].
Une cession ou une licence exclusive peuvent conférer au cessionnaire ou au licencié le droit d’agir en contrefaçon pour des faits antérieurs à l’acte[221]. Le licencié exclusif a le même droit d’agir que le concédant au regard des contrefaçons postérieures à la conclusion de la licence.
Enfin, les actes emportant transfert et nantissement de brevets ou de demandes de brevets doivent être enregistrés auprès de l’UKIPO, sous peine d’inopposabilité aux tiers[222]. Cette règle s’applique également à la concession, la cession ou la mise en gage d’une licence ou d’une sous-licence, ainsi qu’aux évènements et jugements emportant dévolution du brevet.
339._ Les licences de droit_ La section 46 du Patents Act 1977 permet au titulaire du brevet d’indiquer par une inscription que son brevet peut faire l’objet d’une licence de droit. Au vu de la demande d’inscription, le Contrôleur notifie alors tout ayant droit enregistré et procède à l’inscription si les contrats enregistrés ne l’interdisent pas. Toute personne peut alors obtenir la concession d’une licence sur le brevet aux conditions qui peuvent être fixées par un accord ou, à défaut d’accord, par le Contrôleur sur requête du propriétaire du brevet ou du demandeur à la licence. L’inscription a pour effet de réduire de moitié le montant des annuités. La radiation de l’inscription peut être demandée à tout moment[223].
Une licence de droit peut également être inscrite sur le registre par le Contrôleur dans le cadre de l’application des règles de concurrence, à la suite d’un rapport de la Competition Commission, et sur demande des ministres compétents[224].
340._ Les licences obligatoires_ Aux termes de la section 38 du Patents Act 1977, à tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans ou de tout autre délai qui peut être prescrit à compter de la date de la délivrance d’un brevet, toute personne peut demander au Contrôleur une licence portant sur le brevet ou encore l’inscription au registre d’une mention relative à la disponibilité de licences de droit sur le brevet. Les motifs d’octroi d’une licence obligatoire sont définis aux sections 48A et 48B. L’article 48A s’applique lorsque le titulaire est national d’un pays membre de l’OMC, ou est domicilié ou possède un établissement commercial réel et effectif dans un pays membre de l’OMC (WTO Proprietor, « titulaire OMC ») [225]. La section 48B s’applique dans les autres cas.
Pour les « titulaires OMC », les motifs sont les suivants[226] :
(a) Si l’invention brevetée est un produit, lorsque la demande au Royaume-Uni pour ce produit n’est pas satisfaite à des conditions raisonnables ;
(b) En raison du refus du propriétaire du brevet concerné d’accorder une licence ou des licences à des conditions raisonnables :
(i) si l’exploitation au Royaume-Uni de toute autre invention brevetée qui comporte une avance technique importante présentant une importance économique considérable par rapport à l’invention pour laquelle le brevet concerné a été accordé est empêchée ou gênée (dans ce cas sous condition d’octroi réciproque de licence), ou
(ii) si l’établissement ou le développement des activités commerciales ou industrielles au Royaume-Uni est injustement compromis (unfairly prejudiced) ;
(c) si en raison des conditions imposées par le propriétaire du brevet la fabrication, l’utilisation ou la disposition d’éléments non protégés par le brevet, ou l’établissement ou le développement des activités commerciales ou industrielles au Royaume-Uni, est injustement compromis.
Aucune licence obligatoire ne peut être accordée si le demandeur n’a pas fait préalablement des efforts aux fins d’obtenir une licence négociée[227]. Ces licences ne sont pas applicables si l’invention relève du domaine de la technologie des semi-conducteurs[228].
Les licences obligatoires sont non exclusives et incessibles, sont destinées principalement à l’approvisionnement du marché national, doivent inclure une rémunération adéquate et sont limitées dans leur étendue et dans leur durée à la réalisation des objectifs les justifiant[229].
Les motifs d’octroi d’une licence obligatoire pour les brevets dont les titulaires ne sont pas titulaires OMC[230] sont définis de manière plus large.
En pratique les demandes de licence obligatoire sont très rares.
341._ Les obligations du breveté_ Le brevet doit être renouvelé quatre ans après la date de dépôt, puis annuellement par la suite. Le renouvellement s’accompagne du paiement d’une redevance, qui augmente jusqu’au dernier renouvellement.
| Année | Redevance |
| 5ème | £70 |
| 6ème | £90 |
| 7ème | £110 |
| 8ème | £130 |
| 9ème | £150 |
| 10ème | £170 |
| 11ème | £190 |
| 12ème | £220 |
| 13ème | £260 |
| 14ème | £300 |
| 15ème | £360 |
| 16ème | £420 |
| 17ème | £470 |
| 18ème | £520 |
| 19ème | £570 |
| 20ème | £610 |
Le renouvellement peut avoir lieu dans les trois mois précédant la date anniversaire. Un renouvellement tardif peut avoir lieu dans les six mois après la fin de la période de renouvellement, moyennant paiement d’une somme supplémentaire. A défaut, le brevet expire[231]. Le brevet peut cependant être restauré sur demande formulée au Contrôleur dans les treize mois suivant l’expiration de la période de six mois précitée, s’il est démontré au Contrôleur que le défaut de renouvellement est involontaire[232].
4. La défense des droits
342._ La contrefaçon _ Les actes de contrefaçon sont définis à la section 60(1) à (3) du Patents Act, et correspondent aux droits exclusifs et aux actes secondaires déjà présentés[233]. Ces actes doivent avoir été effectués sur le territoire du Royaume-Uni[234]. La contrefaçon primaire ne requiert pas d’élément intentionnel (elle est de strict liability). Un élément intentionnel est requis pour les actes secondaires de contrefaçon[235].
343._ Le droit d’agir en contrefaçon_ Le droit d’agir en contrefaçon d’un brevet appartient au titulaire du brevet[236] et aux licenciés exclusifs[237]. Le titulaire du brevet doit être joint à toute procédure engagée par un licencié exclusif[238].
Le copropriétaire d’un brevet peut, sans le concours des autres copropriétaires, engager, une action en contrefaçon du brevet [239]. Il doit cependant joindre l’ensemble des copropriétaires à la procédure en tant que parties; les autres copropriétaires joints à la procédure en tant que défendeurs ne sont tenus aux frais ou dépens que s’il comparaissent et participent à la procédure.
Le cessionnaire ou le licencié exclusifs ne peuvent obtenir certains dommages et intérêts (costs or expenses) au titre des contrefaçons antérieures à l’enregistrement de l’acte de cession ou de licence au registre des brevets, sauf pour les actes intervenus moins de six mois avant cet enregistrement, ou si le tribunal ou le Contrôleur est convaincu qu’il n’était pas possible d’enregistrer la transaction, l’instrument ou l’événement avant l’expiration de ce délai et que l’enregistrement a été effectué dès que possible après cette expiration[240].
Enfin, la section 69 du Patents Act 1977 prévoit que la demande de brevet assure provisoirement au demandeur la protection prévue pour les brevets délivrés, et que ce dernier peut agir en contrefaçon aux fins d’obtenir des dommages et intérêts. Cependant aucune procédure ne peut être initiée avant publication officielle du brevet.
344._ La compétence_ Les règles de compétences ont été décrites dans l’introduction de cet ouvrage[241]. Rappelons que le Copyright, Designs and Patents Act 1988 avait institué la Patents County Court, exclusivement compétente en matière de brevets, de dessins ou modèles et de questions annexes[242], et que cette juridiction a été remplacée en 2013 par l’Intellectual Property Enterprise Court (IPEC).
345._ L’appréciation de la contrefaçon : l’interprétation des revendications_ L’appréciation de la contrefaçon repose sur l’interprétation des revendications, qui déterminent la portée de l’invention. Ce point est confirmé par la section 125(1) du Patents Act 1977, qui reprend les termes de l’article 69(1) de la Convention sur le brevet européen, et dispose:
« Aux fins de la présente loi, une invention pour laquelle un brevet a été demandé ou délivré est réputée, sauf si un sens différent ressort du contexte, être celle qui est mentionnée dans une revendication du mémoire descriptif figurant dans la demande ou le brevet, selon le cas, telle qu’elle est interprétée à l’aide de la description et de tous dessins figurant dans ce mémoire descriptif, et l’étendue de la protection conférée par un brevet ou par une demande de brevet doit être déterminée en conséquence. »
En vertu de la section 125(3) du Patents Act 1977, le protocole interprétatif de l’article 69 CBE[243] s’applique aux fins d’interprétation de la section 125(1).
Les juges anglais refusent traditionnellement l’interprétation littérale des revendications et favorisent, en cas de difficulté d’interprétation, une interprétation raisonnable. Dans l’affaire Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd[244], la Chambre des Lords a résumé l’approche de base comme suit :
« My Lords, une spécification de brevet est une déclaration unilatérale faite par le breveté, dans des termes qu’il choisit, adressée à ceux qui peuvent avoir un intérêt pratique dans l’objet de son invention (c’est-à-dire aux hommes du métier), par laquelle il les informe de ce qu’il revendique comme étant les caractéristiques essentielles du nouveau produit ou procédé pour lequel la lettre patente lui confère un monopole. Ce sont seulement ces caractéristiques nouvelles qu’il revendique comme essentielles, qui constituent l’essence et le fond (the socalled « pith and marrow ») de la demande. Une spécification de brevet devrait être interprétée conformément à son objet (should be given a purposive construction), plutôt que d’une façon littérale en appliquant le genre d’analyse verbale méticuleuse que les juristes sont, par formation, trop souvent enclins à appliquer. La question est de savoir si, pour des personnes possédant une connaissance et une expérience pratique dans le domaine de l’invention, le déposant a considéré que la stricte application d’un mot ou d’une phrase particulière constitue un élément essentiel de l’invention, de sorte que toute variante tomberait en dehors du monopole revendiqué, même si cela n’a aucun effet sur la façon dont l’invention fonctionne »[245].
Dans LG Philips LCD Co Ltd v Tatung (UK) Ltd[246], la Cour d’appel a précisé que:
« Le simple fait qu’un mot, une phrase ou un autre élément dans une revendication ne soit pas clair ne saurait entraîner automatiquement l’invalidité de la revendication. Cela imposerait un standard bien trop élevé et irréaliste de rédaction dans tous les domaines ; une telle approche serait particulièrement inadaptée à la rédaction des brevets, qui est dans beaucoup de situations un exercice notoirement difficile. Une revendication doit être aussi claire que son objet le permet raisonnablement »[247].
Enfin, les principes d’interprétation ont été reformulés, au regard de la question des variantes, par la Cour d’appel de Londres dans l’arrêt Improver Corp v Remington Consumer Products Ltd[248] comme suit :
« Si la question est savoir si une caractéristique d’une contrefaçon alléguée qui n’est pas couverte par le sens premier, littéral ou contextuel d’un mot ou d’une phrase d’une revendication (une « variante ») est néanmoins couverte par son langage correctement interprété, le tribunal doit se poser les trois questions suivantes :
1) La variante a-t-elle un effet important sur la façon dont l’invention fonctionne ? Si la réponse est oui, la variante n’est pas couverte par la revendication (et n’est pas contrefaisante). Si la réponse est non :
2) Est-ce que cette variante (qui n’a donc pas d’effet important sur la façon dont l’invention fonctionne) aurait été évidente à la date de publication du brevet pour un homme du métier ? Si la réponse est non, la variante n’est pas couverte pas la revendication. Si la réponse est oui :
3) Est-ce que l’homme du métier aurait néanmoins compris à la lecture de la revendication que le breveté entendait le strict respect du sens premier comme un élément essentiel de l’invention ? si la réponse est oui, la variante n’est pas couverte par l’invention.
D’un autre côté, une réponse négative à la dernière question entraînerait la conclusion que le titulaire du brevet ne voulait pas donner un sens littéral au mot ou la phrase, mais plutôt un sens figuré (la figure étant une forme de synecdoque ou métonymie) dénotant une catégorie de choses incluant la variante et le sens littéral, ce dernier étant peut-être l’exemple le plus parfait, le plus connu ou le plus frappant de la catégorie »[249]
346._ Les équivalents_ Traditionnellement le droit anglais des brevets ne connaît pas de doctrine des équivalents[250]. Cependant, comme indiqué, la section 125(3) du Patents Act 1977 dispose que le protocole interprétatif de l’article 69 CBE, qui prévoit la prise en compte d’équivalents[251], s’applique aux fins d’application de la section 125(1). Le test de contrefaçon issu de l’arrêt Catnic, tel que reformulé par l’arrêt Improver Corp v Remington Consumer Products Ltd précité[252], intègre désormais dans sa troisième question la prise en compte des équivalents.
347._ Les moyens de défense _ Outre la contestation de la validité ou de la portée du brevet (incluant l’application des exceptions légales), ou une défense fondée sur le droit de la concurrence[253], le défendeur à une action en contrefaçon peut invoquer les doctrines d’estoppel et de laches, déjà décrites dans notre section sur le copyright[254].
349._ Remèdes et sanctions (renvoi)_ Ils ont été décrits en introduction à cet ouvrage[255].
349._ Les menaces d’action en contrefaçon infondées_ La section 70 du Patents Act 1977 prévoit la possibilité de sanctions contre une personne menaçant une autre personne d’une procédure en contrefaçon de brevet infondée[256].
350._ L’annulation des brevets (revocation of patents)_ Outre la possibilité de contester la validité d’un brevet par voie d’exception ou d’action dans le cadre d’une action en contrefaçon ou d’une autre action prévue par la loi (notamment en déclaration d’absence de contrefaçon)[257], en application de la section 72 du Patents Act toute personne, intéressée ou non au brevet, peut former, même en l’absence de litige ou menace de litige, une demande en annulation du brevet (revocation of patents) auprès des tribunaux compétents (la Patents Court ou l’Intellectual Property Enterprise Court – IPEC – selon le cas[258]), mais également directement auprès de l’Intellectual Property Office[259]. Ce recours en révocation se rapproche alors de la procédure d’opposition post délivrance en matière de brevet européen[260]. La procédure de révocation semble cependant plus rapide en pratique, et n’est pas soumise au délai de neuf mois de l’opposition européenne.
La révocation du brevet peut être prononcée exclusivement pour l’un des motifs suivants:
« (a) l’invention n’est pas une invention brevetable;
(b) le brevet a été délivré à une personne qui n’avait pas le droit d’obtenir la délivrance du brevet;
(c) le mémoire descriptif du brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter;
(d) les éléments divulgués dans le mémoire descriptif du brevet s’étendent au-delà de ceux divulgués dans la demande de brevet telle qu’elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré à la suite d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 8(3) , 12 ou 37(4) ou de la manière prévue à l’article 15(9), dans la demande antérieure telle qu’elle a été déposée;
(e) la protection conférée par le brevet a été étendue par une modification qui n’aurait pas dû être autorisée »[261].
Ces motifs correspondent aux motifs d’opposition devant l’OEB[262], sauf l’absence de droit au brevet (point (b)). Ce dernier motif ne peut être invoqué que par la personne reconnue éligible au brevet par le tribunal ou l’Intellectual Property Office[263].
Le Contrôleur peut également révoquer de sa propre initiative un brevet dans les conditions posées par la section 73 du Patents Act pour défaut de nouveauté. Il doit cependant accorder au propriétaire du brevet la faculté de présenter des observations et de restreindre la portée du brevet. Le Contrôleur peut également prendre une décision d’annulation s’il estime qu’un brevet délivré en vertu de la loi et un brevet européen ont été délivrés pour la même invention bénéficiant de la même date de priorité et que les demandes de brevet ont été déposées par le même déposant ou son ayant cause.
A noter qu’il est possible de demander au Contrôleur une simple opinion sur la validité d’un brevet au regard des conditions de nouveauté et d’activité inventive[264].
351._ L’action en déclaration de non-contrefaçon_ La section 71 du Patents Act 1977 permet à un tribunal, mais également au Contrôleur des brevets (avec le même effet), d’accorder une déclaration de non-contrefaçon d’un brevet (national ou européen (RU)) s’il est démontré (a) que le demandeur s’est adressé par écrit au propriétaire pour en obtenir une reconnaissance écrite aux fins de la déclaration demandée et lui a fourni par écrit tous détails relatifs à l’acte en cause[265], et (b) que le propriétaire a refusé ou omis de d’accorder cette reconnaissance. Le tribunal éventuellement saisi d’une action en contrefaçon intentée pendant la procédure doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Contrôleur (même principe que pour l’action en révocation précitée). En revanche, si l’action en contrefaçon était pendante, une autorisation du tribunal (leave) est nécessaire avant toute saisine du Contrôleur.
- Source: UKIPO, Facts and figures: patents, trade marks, designs and hearings: 2023. ↵
- Avec un peu plus de 14 746 demandes et 12 421 brevets accordés en 2022. Source: OMPI, Centre de données statistiques. ↵
- Avec 57 213 demandes et 23 592 brevets accordés en 2022. Ibid. ↵
- On comptait par exemple 20 931 demandes en 2018, et 18 854 en 2021, pour respectivement 5 982 et 10 899 brevets délivrés. Source: UKIPO, Facts and figures: patents, trade marks, designs and hearings: 2023. ↵
- V. infra, n° 304. ↵
- Source, UKIPO, The changing profile of users of the UK patent system, 2021, p. 11. ↵
- Ibid., p. 12. ↵
- Ibid., p. 14. Le nombre de demandes en provenance de la Chine a quant à lui plus que doublé en 2020 par rapport à 2019. Ibid., p. 16. Celles en provenance du reste du monde sont restées globalement stables. ↵
- V. Tome 1, n°28 et suivants. ↵
- Ratifié le 24 octobre 1977, et entré en vigueur le 24 janvier 1978. ↵
- Ratifié le 26 mai 1972 et entré en vigueur le 7 octobre 1975. ↵
- Ratifié le 29 septembre 1980 et entré en vigueur le 29 décembre 1980. ↵
- Ratifié le 22 décembre 2005 et entré en vigueur le 22 mars 2006. ↵
- Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE) du 5 octobre 1973 (CBE). ↵
- Cons. UE, déc. 2020/2252, 29 déc. 2020 : JOUE n° L 149/10, 30 avr. 2021. ↵
- Communiqué de presse du 28 novembre 2016 « UK signals green light to Unified Patent Court Agreement », www.gov.uk. ↵
- V. infra, n° 304. ↵
- V. Tome 1, n° 21 à 37. ↵
- 2019/C 384 I/01, JO UE 12 nov. 2019. ↵
- Accord, art. 54. ↵
- Accord, art. 55. ↵
- Accord, art. 56. ↵
- Accord, art. 57. ↵
- Accord, art. 58. ↵
- Accord, art. 59. ↵
- Accord, art. 60. ↵
- Accord, art. 61. ↵
- European Union (Withdrawal Act) 2018 (c. 16); European Union (Withdrawal Act) 2020 (c. 1). ↵
- Cons. UE, déc. 2020/2252, 29 déc. 2020 : JOUE n° L 149/10, 30 avr. 2021. ↵
- Accord UE/RU, art. 219 à 275. ↵
- Accord UE/RU, art. 250 et 251. ↵
- Accord UE/RU, art. 253. ↵
- Accord UE/RU, art. 254. ↵
- V. Tome I, Partie I, Chapitre 5. ↵
- N. Davenport, The United Kingdom Patent System: A Brief History, Mason 1979. ↵
- La première fut accordée en 1311. ↵
- V. Tome 1, n°72. ↵
- R. A. Klitzke, Historical background of the English patent law. 41 J. Pat. Off. Soc’y 615 (1959), p. 635. ↵
- A proclamation for the reformation of many abuses and misdemeanors committed by patentees of certain privileges and licenses, to the general good of all her Majesty's loving subjects (Nov. 28, 1601), reprinted in 2 Tudor Royal Proclamations 235, 237 (Paul L. Hughes & James F. Larkin eds., 1969). Au préalable la Star Chamber (qui n’était pas une cour de common law) avait compétence exclusive sur les affaires concernant les lettres patentes. ↵
- Edward Darcy Esquire v Thomas Allin of London Haberdasher, (1602) 77 Eng Rep 1260 (KB), (1603) 11 Co. Rep. 84b. ↵
- Titre complet: "A declaration of his majesties royall pleasure, in what sort he thinketh fit to enlarge, or reserve himselfe in matter of bountie". ↵
- (1614) Godb. R. 252. ↵
- Legislation.gov.uk.: Statute of Monopolies 1623, 1623 Ch 3 21 Ja 1. ↵
- Statute of Monopolies, 1624, 21 Jac.I, c.3.; Deazley, R. (2008) ‘Commentary on the Statute of Monopolies 1624', in Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org; M. Fisher, The Statute of Monopolies and Modern Patent Law: Foundation or Elaborate Folly? Intellectual Property Quarterly , 2022 (4) pp. 176-207; Dent, Chris, 'Generally Inconvenient': The 1624 Statute of Monopolies as Political Compromise (February, 16 2010). Melbourne Univeristy Law Review, Vol. 33, No. 2, 2009, U of Melbourne Legal Studies Research Paper No. 452, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1554190. ↵
- Correspondant à deux cycles d’apprentissage. ↵
- § 6(a) dans le texte cité. ↵
- V. texte sur Legislation.gov.uk. Les lettres patentes n’ont pas non plus disparu du droit anglais, mais ne concernent plus les monopoles. ↵
- Charles Dickens en donnera un aperçu dans une nouvelle de 1850 intitulée « A Poor Man's Tale of a Patent ». ↵
- Au travers du Patent Law Amendment Act de 1852. ↵
- J. E. Crawford Munro, The Patents, Designs, and Trade Marks Act, 1883 (46 & 47 Vict. C. 57) with the Rules and Instructions: Together with Pleadings, Orders, and Precedents, Google books. ↵
- F.K. Beier, The Inventive Step in Its Historisal Development (1986) 17 International Review of Industrial Property and Copyright Law 301, 312. ↵
- Patents Act 1949, 1949 c. 87 (Regnal. 12_13_and_14_Geo_6). ↵
- Patents Act 1977, 1977 c. 37. ↵
- The Patents Rules 2007, SI 2007 No. 3291. ↵
- « Attendu que, dans une résolution adoptée lors de la signature de la Convention sur le brevet communautaire, les gouvernements des États membres de la Communauté économique européenne sont convenus d’aménager leurs législations en matière de brevets de manière (notamment) à les adapter aux dispositions correspondantes de la Convention sur le brevet européen, de la Convention sur le brevet communautaire et du Traité de coopération en matière de brevets, il est expressément déclaré par la présente disposition que les dispositions suivantes de la présente loi, à savoir les sections 1.1) à 4), 2 à 6, 14.3), 5) et 6), 37.5), 54, 60, 69, 72.1) et 2), 74.4), 82, 83, 100 et 125, sont conçues de manière à produire dans toute la mesure du possible les mêmes effets au Royaume-Uni que ceux que les dispositions correspondantes de la Convention sur le brevet européen, de la Convention sur le brevet communautaire et du Traité de coopération en matière de brevets produisent sur les territoires auxquels ces textes s’appliquent ». ↵
- [1996] RPC 76. ↵
- Lord Hoffmann, page 82. V. également Human Genome Sciences v Eli Lilly [2011] UKSC 51, [2012] RPC 6; Actavis UK Ltd v Merck [2008] EWCA Civ 444; R. v Secretary of State for Work and Pensions [2008] UKHL 63. Ce qui n’empêchera pas des divergences et des remarques peu amènes échangées avec l’OEB, notamment à l’occasion de l’affaire Aerotel (V. infra, n°285). ↵
- V. supra, n°314. ↵
- V. infra, n°325. ↵
- L. n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. ↵
- Là encore, il faut tenir compte des réformes issues en France de la Loi PACTE, et notamment du nouveau droit d'opposition (encadré par l’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 et complétée par le décret n° 2020-225 du 6 mars 2020). ↵
- V. cependant l’unregistered design right, Tome 1, n°288. ↵
- Le Patents Act 1949 reprenait la formule du Statues of Monopoles et définissait l’invention comme « any manner of new manufacture the subject of letters patent and grant of privilege within section six of the Statute of Monopolies of Monopolies and any new method or process of testing applicable to the improvement or control of manufacture, and includes an alleged invention » (Section 101). ↵
- V. infra, n°313. ↵
- Ibid. ↵
- Biogen Inc v Medeva plc, [1996] UKHL 18, (1997) 38 BMLR 149, [1997] RPC 1. ↵
- Exclusion ancienne, inscrite à la s. 1(2) du Patents Act, v. infra, n°313. ↵
- V. cette remarque de la High court d'Australie dans National Research Development Corporation v. Commissioner of Patents (1959) 102 CLR 252 (High Court d'Australie): "the truth is that the distinction between discovery and invention is not precise enough to be other than misleading in this area of discussion". ↵
- V. CFPH LLC, Patent Applications by [2005] EWHC 1589 (Pat) (21 July 2005): "An instance of a "soft" exclusion is a discovery. It is well-settled law that, although you cannot patent a discovery, you can patent a useful artefact or process that you were able to devise once you had made your discovery. This is so even where it was perfectly obvious how to devise the artefact or process, once you had made the discovery (Genentech’s Patent [1987] RPC 553, 566; on appeal [1989] RPC 147, 208, 240, C.A.). The detractors of your patent are not allowed to say: the discovery does not count and the rest was obvious. They are not allowed to dissect your invention in that way. The discovery is an integral and all-important part of your invention. The law does not object to that. It objects only when you try to monopolise your discovery for all purposes i.e. divorced from your new artefact or process. For that would enable you to stifle the creation of further artefacts or processes which you yourself were not able to think of". ↵
- Genentech Inc.’s Patent, [1989] RPC 147 (CA). ↵
- Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel, [2004] UKHL 46, [2005] All ER 667; 64 IPR 444; [2005] RPC 169. ↵
- V. infra, n°389 et 390. ↵
- Décisions de la section de dépôt de l'OEB du 27 janvier 2020, rejetant les demandes de brevet EP 18 275 162 et EP 18 275 174 désignant en qualité d'inventeur le programme d'intelligence artificielle DABUS, confirmées par décision de la chambre de recours juridique de l'OEB du 21 décembre 2020. ↵
- Avec un premier brevet délivré par l'Office sud-africain (patent no. 2021/03242), publié en juillet 2021, pour l'invention relevié au conteneur d'aliment ou de boisson (V. ci-après). On notera cependant que l'examen opéré par l'Office est limité. ↵
- Demande no. 2019363177 du 9 septembre 2020 (PCT/IB2019/057809), rejetée par le Patent Office, au motif que l'inventeur au sens de la section 15(1) du Patents Act de 1990 ne peut être qu'un être humain. Position finalement confirmée par un arrêt de la Cour Fédérale d'Australie le 13 avril 2022: Australian law in Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62 (qui infirme Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879; 160 IPR 72). ↵
- Décision de rejet du Patent office du 31 janvier 2022, confirmée par la High Court, Thaler v Commissioner of Patents [2023] NZHC 554 (17 March 2023). ↵
- No. GB1816909.4 et GB1818161.0. ↵
- Patents Act 1977, s. 13, et SI 2007/3291, rule 10(3). ↵
- No. BL O/741/19. Plus précisément, la décision précise que les demandes sont réputées retirées à l'expiration du délai de seize mois prévu à la section 10(3) précitée. ↵
- Thaler v Comptroller-General of Patents Trade Marks and Designs, [2020] EWHC 2412 (Pat), [2020] Bus LR 2146, Marcus Smith J.; Thaler v Comptroller General of Patents Trade Marks And Designs, [2021] EWCA Civ 1374, [2022] Bus LR 375. Comme la High Court, la Cour d'appel confirme que DABUS ne pouvait être considérée comme un inventeur au sens du Patents Act 1977, ce dernier devant nécessairement être une personne physique, et qu'il n'existe pas de règle générale de droit selon laquelle tout bien incorporel (y compris une invention) créé par une machine est la propriété de la machine ou du propriétaire de la machine. ↵
- Thaler v Comptroller-General of Patents, Designs and Trademarks, [2023] UKSC 49. ↵
- La Cour tire également argument du contexte général du Patents Act 1977, et des dispositions des sections 2(4) (divulgations préalables non destructrices de nouveautés), 8 et 37, qui confirment que l'inventeur est bien une personne physique. ↵
- "In my view there are two fundamental problems with these submissions. The first is that they assume that DABUS can itself be an inventor within the meaning of the 1977 Act. But that assumption is not correct for the reasons I have given. DABUS is a machine and not a person. That was reason enough for the Hearing Officer for the Comptroller to reach the conclusion he did. Indeed, it was itself fatal to the applications. There was no inventor through whom Dr Thaler could claim the right to obtain a patent for any technical advance described in those applications.The second is that it mischaracterises an invention as being or amounting to tangible property such that title to it can pass, as a matter of law, to the owner of the machine which, on this assumption, generated it. I accept, of course, that the 1977 Act refers at times to the property in an invention. As we have seen, it does so in, most importantly, section 7(2)(b), and this is the provision on which Dr Thaler places particular reliance. The 1977 Act also contemplates in, for example, section 39, that an invention may be taken as "belonging" to a person, such as an employee or an employer. One must be careful to understand what this means, however. The right we are concerned with, as conferred by the 1977 Act, is a right to apply for a patent for what is said to be an invention and, if it is patentable and satisfies the other requirements of the Act, to secure the grant of a patent on that application. But I am satisfied that Dr Thaler has not identified any basis in law on which he acquired such a right through his ownership of DABUS. In particular, Dr Thaler's reliance on the doctrine of accession in this context is misguided. The doctrine concerns new tangible property produced by existing tangible property. Dr Thaler contends that, upon the application of this doctrine, the owner of the existing property also owns the new property. In this way, the farmer owns the cow and the calf. By analogy, Dr Thaler continues, he, as owner of DABUS, is the owner of all rights in all developments made by DABUS. We are not concerned here with a new item of tangible property produced by an existing item of tangible property, however. We are concerned with what appear (and which for present purposes we must assume) to be concepts for new and non-obvious devices and methods, and descriptions of ways to put them to into practice, all of which, so Dr Thaler maintains, have been generated autonomously by DABUS. There is no principled basis for applying the doctrine of accession in these circumstances. For these reasons and those given by the Court of Appeal, I am satisfied that the doctrine upon which Dr Thaler relies here, that of accession, does not, as a matter of law, operate to confer on him the property in or the right to apply for and obtain a patent for any technical development made by DABUS. It follows that, on the factual assumptions upon which this appeal is proceeding, Dr Thaler has never had any right to secure the grant to himself of patents under the 1977 Act in respect of anything described in the applications". ↵
- V. infra, n°314. ↵
- Sur les découvertes, V. CFPH LLC, Patent Applications by [2005] EWHC 1589 (Pat) (21 July 2005): "An instance of a "soft" exclusion is a discovery. It is well-settled law that, although you cannot patent a discovery, you can patent a useful artefact or process that you were able to devise once you had made your discovery. This is so even where it was perfectly obvious how to devise the artefact or process, once you had made the discovery (Genentech’s Patent [1987] RPC 553, 566; on appeal [1989] RPC 147, 208, 240, C.A.). The detractors of your patent are not allowed to say: the discovery does not count and the rest was obvious. They are not allowed to dissect your invention in that way. The discovery is an integral and all-important part of your invention. The law does not object to that. It objects only when you try to monopolise your discovery for all purposes i.e. divorced from your new artefact or process. For that would enable you to stifle the creation of further artefacts or processes which you yourself were not able to think of" (para. 34). Pour une exclusion, v. Tate & Lyle Technology v Roquette Frères [2009] EWHC 1312 (Pat) (invention consistant uniquement dans l’explication du fonctionnement d’une méthode connue de fabrication de substitut au sucre). ↵
- V. Halliburton Energy Services Inc's Applications [2012] RPC 129 (l’exclusion doit être interprétée restrictivement et couvre uniquement les activités mises en oeuvres par des moyens purement intellectuels). Sur la brevetabilité des jeux, V. Shopalotto.com Ltd’s Application [2006] RPC 7; IGT v The Comptroller-General of Patents [2007] EW HC 1341 (Ch). Sur les méthodes commerciales, v. Aerotel v Telco and Macrossan's Application, [2006] EWHC 997 (Pat) [2006] EWCA Civ 1371. ↵
- V. infra, n°314. ↵
- V. Townsend’s Application [2004] EWHC 482 (Pat) (l’exclusion couvre à la fois la fourniture d’informations et l’expression); Autonomy Corp Ltd v Comptroller General of Patents, Trade Marks & Designs [2008] EWHC 146 (Pat) (le moyen technique de présentation de l’information n’est pas couvert par l’exclusion); Gemstar–TV Guide International Inc v Virgin Media Limited [2010] RPC 10 (Guide électronique de programmes. Exigence d’un effet technique au delà de la présentation de l’information). ↵
- Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd & Ors Rev 1 [2006] EWCA Civ 1371; [2007] RPC 7. ↵
- V. Décision de la CRT T 154/04 du 15 novembre 2006 (Duns Licensing) : « Toute référence à l’état de la technique dans le contexte de l’article 52(2) et (3) CBE conduirait en effet à des difficultés insurmontables. L'art antérieur, ou "état de la technique" selon la terminologie de la Convention, est une notion complexe régie avec précision par une combinaison de dispositions, à savoir les articles 54 à 56 CBE, et dont le contenu dépend des dates de dépôt et de priorité de la demande ou du brevet ainsi que de la condition de brevetabilité impliquée. Il n'existe toutefois aucune règle qui définit l’état de la technique à appliquer dans le contexte de l’article 52(2) CBE. Or, il est tout simplement inconcevable que les États contractants aient oublié un point aussi important lors de l’adoption de la Convention. Il existe donc des raisons convaincantes pour lesquelles il convient d’abandonner l’approche fondée sur la "contribution" ou l’"effet technique", ce que les chambres de recours ont fait il y a une dizaine d’années. (...) Une autre raison pour laquelle "l’approche fondée sur l’effet technique (avec la condition)", qui a été appliquée dans la décision Aerotel/Macrossan, est incompatible avec la Convention sur le brevet européen est qu’elle présuppose qu’un "objet nouveau et inventif, mais entièrement exclu de la brevetabilité", ne compte pas comme contribution technique (Aerotel/Macrossan, p. ex. paragraphe 26(2)) ». ↵
- Confirmé dans Symbian Ltd v Comptroller General of Patents [2008] EWCA Civ 1066, et HTC v. Apple [2013] EWCA Civ 451. Pour les précédents : Merrill Lynch's Application [1989] RPC 561; Gale's Application [1991] RPC 305; Fujitsu Limited's Application [1997] RPC 608. ↵
- V. Article 53(a) CBE. ↵
- Conformément à l’article 6 de la directive 98/44/CE. ↵
- Rappelons que la pratique de l’OEB dans son approche des exclusions de la brevetabilité a été jugée insufisamment fixée dans l’affaire Aerotel précitée. V. également Symbian Ltd’s Application [2009] RPC 1. ↵
- Emotional Perception v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Mark, [2023] WLR(D) 500, [2023] EWHC 2948 (Ch), [2024] Bus LR 14; et sur appel, Comptroller General of Patents v. Emotional Perception AI Limited [2024] EWCA Civ 825. ↵
- V. infra, n°316. ↵
- Emotional Perception v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Mark, [2023] WLR(D) 500, [2023] EWHC 2948 (Ch), [2024] Bus LR 14. ↵
- Point 54 à 58 : "LMs Edwards-Stuart's concession about the operation of a hardware ANN was not accompanied by reasons, but presumably it is because the hardware is not implementing a series of instructions pre-ordained by a human. It is operating according to something that it has learned itself. That, at any rate, would be one justification even if it is not hers. I do not see why the same should not apply to the emulated ANN. It is not implementing code given to it by a human. The structure, in terms of the emulation of uneducated nodes and layers, may well be the result of programming, but that is just the equivalent of the hardware ANN. The actual operation of those nodes and layers inter se is not given to those elements by a human. It is created by the ANN itself. I do not consider that the single sentence from the application which is relied on by Ms Edwards-Stuart is sufficient for her purposes. It appears in the middle of a number of paragraphs which refer to ANNs. It seems to refer to a different method of achieving the results of the invention which does not involve an ANN. It does not seem to be referring to an emulated ANN - it seems to be referring to something different. In the light of all this I am not convinced by the Hearing Officer's lack of conviction. It seems to me that it is appropriate to look at the emulated ANN as, in substance, operating at a different level (albeit metaphorically) from the underlying software on the computer, and it is operating in the same way as the hardware ANN. If the latter is not operating a program then neither is the emulation. I should deal with Ms Edwards-Stuart's submission that there is no difference between what she said was the computer program used to implement the trained ANN and the computer program used to train the ANN, even though the process or method implemented by the computer during training is slightly different. I do not accept this submission. First, they seem to be clearly very different things. Second, it is inconsistent with her submission that in the case of an emulated ANN the relevant "program" is that identified earlier in this section, that is to say the internal workings of a trained ANN. I therefore consider that the "decoupling" can be achieved and is correct and the emulated ANN is not a program for a computer for these purposes". ↵
- Point 59. ↵
- Comptroller of Patents v Emotional Perception AI Ltd [2024] EWCA Civ 825. ↵
- Points 61 à 63: "I start with the term computer. I would hold that a computer is a machine which processes information. Neither party came up with a better definition and I believe that is a useful one. Turning to computer program, (which is the same thing as a "program for a computer"), in terms of the meaning of a statute, dictionary definitions are not determinative but in this case I think the definitions are helpful. I would hold that a computer program is a set of instructions for a computer to do something. These two definitions work together, so one can say that a computer is a machine which does something, and that thing it does is to process information in a particular way. The program is the set of instructions which cause the machine to process the information in that particular way, rather than in another way. This focus on a program as instructions is consistent with the approach of the Court of Appeal in Gale's Application [1991] RPC 305, at p321 (ln 13-19), in which Nicholls LJ, who was considering what a program was in the context of a case about a conventional sort of computer, noted that "program" was a flexible term and that "a sequence of instructions" was called a program. It is also consistent with the approach of the Court of Appeal in Aerotel at [31], in which Jacob LJ, giving the judgment of the court, described a computer program as a "set of instructions". This was in the context of a debate whether the term was limited to the set of instructions in the abstract or included the instructions on some form of media (referring back to Gale) and preferring the latter". ↵
- Points 64 à 67: "Much of EPL's argument here sought to add various limitations into the definition. The first limitation related to the involvement of a human computer programmer. I do not believe that referring to a human programmer is relevant or helpful. I can think of no principle which would justify that as a necessary aspect of the definition and the authorities in this area have never drawn a distinction of that kind. The code which human programmers write for conventional computers is written in a form which is sometimes called a high level programming language. That is a form which human programmers can understand and grapple with. However, as the Comptroller submitted, ordinary computers work by running machine code, which is different and hard for humans to understand. The machine code is derived by a computer system (normally what is called a compiler program) under the direction of a human programmer. There is no justification for drawing a distinction in law between instructions created by a computer and those created by a human. Nor do I accept that focussing on the characteristics of the problem the programmer wants to solve (tractable or intractable) is relevant or helpful either. The fact that ANNs aim to solve problems which are not easy to solve with conventional computers is irrelevant. Both conventional computers and ANNs can (aim to) solve problems which are difficult for humans to solve unaided. The respondent puts weight on the fact that the particular values for the weights are produced by a training process in which the machine learns for itself, but I do not see how that can be relevant either. This argument is related to the two previous arguments in that it is focussed on the manner in which the instructions are produced. As I have said I do not accept there is justification for that either in principle or in the Act (or the international conventions: EPC or TRIPS). How the program came into being is irrelevant. Another distinction which I believe is irrelevant relates to permanence. There are some computers with programs which cannot be changed – e.g. the chips embedded in a payment card or a washing machine – but it remains meaningful to draw the same distinction between the program in that case and the computer itself. Whether the program for a given computer is fixed in a permanent form or not does not, in my judgment, alter the fact that the program represents a set of instructions for a computer to do something. The result in Gale, which involved rejecting a distinction between the permanence of instructions in ROM circuitry as opposed to those stored in other media would have been quite different if this distinction was relevant". ↵
- Points 68 à 70: "Turning to an ANN, the first point to make is that however it is implemented, such a machine is clearly a computer – it is a machine for processing information. Focussing on the weights of an ANN, in my judgment irrespective of the manner in which an ANN is implemented (hardware or software), the Comptroller is right that these weights are a computer program. They are a set of instructions for a computer to do something. For a given machine, a different set of weights will cause the machine to process information in a different way. The fact the set does not take the form of a logical series of 'if-then' type statements is irrelevant. The weights for a given artificial neuron are what cause the neuron, if the inputs are of a given type, to then produce an output of a given type. Aggregated up to the ANN as a whole, these weights work that way in parallel with one another to a significant extent and not just in a logical series, but that is not a relevant distinction. The set of weights as a whole instruct the machine to process information it is presented with in a particular way. It is notable that the Technical Boards of Appeal of the EPO take the same approach: see decision T 702/20 Mitsubishi/Sparsely connected neural network at [10] and [11]. Here the Board of Appeal applied exactly the same approach to a case about an ANN as it applies to other computer implemented inventions. At [10] the Board held explicitly that since "a neural network relates to both programs for computers and to mathematical methods", the question was whether it related only to such subject-matter "as such" or whether there was something more, i.e. something that can fulfil the patentability conditions of the EPC. Therefore the exclusion from patentability of a program for a computer as such in s1(2) of the 1977 Act is engaged in this case. Nor is there any difference for this purpose between a hardware ANN and a software ANN. However it is implemented, the weights (by which I mean weights and biases) of the ANN are a program for a computer and therefore within the purview of the exclusion". ↵
- V. supra n°313. ↵
- Halliburton Energy Services Inc's Applications [2011] EWHC 2508 (Pat); [2012] R.P.C. 12. ↵
- Par HHJ Birss QC. ↵
- Symbian Ltd v Comptroller-General of Patents [2008] EWCA Civ 1066, [2009] R.P.C. 1. ↵
- V. para 53 à 56: « 53.Based on these principles, we consider that Patten J was right and that the claimed invention does make a technical contribution, and is not therefore precluded from registration by art 52(2)(c). To start with a defensive point, the program in this case does not embody any of the items specifically excluded by the other categories in art 52; thus, it is not a method of doing business (as in Merrill Lynch), or a mathematical method (as in Gale), or a method for performing mental acts (as was probably the case in Fujitsu). 54.More positively, not only will a computer containing the instructions in question "be a better computer", as in Gale, but, unlike in that case, it can also be said that the instructions "solve a 'technical' problem lying with the computer itself". Indeed, the effect of the instant alleged invention is not merely within the computer programmed with the relevant instructions. The beneficial consequences of those instructions will feed into the cameras and other devices and products, which, as mentioned at [3] above, include such computer systems. Further, the fact that the improvement may be to software programmed into the computer rather than hardware forming part of the computer cannot make a difference – see Vicom; indeed the point was also made by Fox LJ in Merrill Lynch. 55.As Patten J said at [63], there is support in for this conclusion, albeit in an obiter dictum, in [92] of the judgment of this court Aerotel. Jacob LJ said that in Gale it was decided that, in order to avoid the reach of the art 52(2)(c) exclusion, "[m]ore is needed" than "a code as embodied on a physical medium which causes the computer to operate in accordance with that code", and then gave as an example "for instance, a change in the speed with which the computer works". The effect of the alleged invention in the present case improves the speed and the reliability of the functioning of the computer. 56.Putting it another way, a computer with this program operates better than a similar prior art computer. To say "oh but that is only because it is a better program – the computer itself is unchanged" gives no credit to the practical reality of what is achieved by the program. As a matter of such reality there is more than just a "better program", there is a faster and more reliable computer ». ↵
- AT&T Knowledge Ventures/Cvon Innovations v Comptroller General of Patents [2009] EWHC 343 (Pat). ↵
- "As Lord Neuberger pointed out, it is impossible to define the meaning of "technical effect" in this context, but it seems to me that useful signposts to a relevant technical effect are:i) whether the claimed technical effect has a technical effect on a process which is carried on outside the computer;ii) whether the claimed technical effect operates at the level of the architecture of the computer; that is to say whether the effect is produced irrespective of the data being processed or the applications being run;iii) whether the claimed technical effect results in the computer being made to operate in a new way;iv) whether there is an increase in the speed or reliability of the computer;v) whether the perceived problem is overcome by the claimed invention as opposed to merely being circumvented.If there is a technical effect in this sense, it is still necessary to consider whether the claimed technical effect lies solely in excluded matter" (points 40 et 41). ↵
- HTC v Apple [2013] EWCA Civ 451. Le brevet européen litigieux portait sur des dispositifs informatiques dotés d'écrans tactiles capables de réagir simultanément à plusieurs contacts tactiles, et revendiquant des logiciels. Jugé que le problème que le brevet cherchait à résoudre revêtait un caractère essentiellement technique. La solution contenue dans le logiciel permet au dispositif de fonctionner d'une manière nouvelle et améliorée. Jugé que l'invention apporte bien une contribution à l'état de la technique et que cette contribution n'entre pas dans la catégorie des objets exclus. ↵
- Lantana v Comptroller-General of Patents [2013] EW HC 2673 (Pat), confirmé par Lantana Ltd v. Comptroller General of Patents [2014] EWCA (Civ) 1463 (logiciel de récupération de données électroniques permettant de transférer des données à un autre ordinateur par courrier électronique ; revendication nouvelle et inventive, mais le demandeur ne démontrait pas une contribution présentant caractère technique; jugé que la revendication portait sur un objet exclu de la brevetabilité et était contraire à la s.1(2) du Patents Act 1977 et à l’article 52 de la CBE). ↵
- Hutchins’ Application [2003] R.P.C. 264 (logiciel donnant des instructions de réanimation); Fujitsu’s Application [1997] EWCA Civ 1174 (6 March 1997), [1997] R.P.C. 608 CA (logiciel convertissant des données sur la structure de cristaux); Gale’s Application [1991] R.P.C. 305 (nouvelle méthode mise en œuvre par un programme pour calculer des racines carrées) ; Merrill Lynch’s Application [1989] R.P.C. 561 CA (logiciel d’analyse d’ordres donnés en bourse, effectuant automatiquement les prises d’ordres selon des critères prédéfinis; l’effet est jugé juridique et non technique). ↵
- Points 76 à 78: "The Hearing Officer was right to acknowledge that the result of the invention was an effect external to the computer in the transmission of a chosen file. That is usefully analogous to the file that was moved in the third Gemstar patent. The correct view of what happened, for these purposes, is that a file has been identified, and then moved, because it fulfilled certain criteria. True it is that those criteria are not technical criteria in the sense that they can be described in purely technical terms, but they are criteria nonetheless, and the ANN has certainly gone about its analysis and selection in a technical way. It is not just any old file; it is a file identified as being semantically similar by the application of technical criteria which the system has worked out for itself. So the output is of a file that would not otherwise be selected. That seems to me to be a technical effect outside the computer for these purposes, and when coupled with the purpose and method of selection it fulfils the requirement of technical effect in order to escape the exclusion. (...) If, contrary to my findings, one were considering those two program candidates, it seems to me that the resulting ANN, and particularly a trained hardware ANN, can be regarded as a technical effect which prevents the exclusion applying. At the hearing Ms Edwards-Stuart seemed to accept, in argument, that a trained ANN could be a technical advance for these purposes, but proposed that it had to be defined in terms of the actual function of each of its nodes so as to be identifiable as a particular ANN, or be determined by reference to the training that it received. The first of those is obviously not part of the application, but I do not see why the second, or something very close to it, has not been achieved. I therefore consider that, insofar as necessary, the trained hardware ANN is capable of being an external technical effect which prevents the exclusion applying to any prior computer program. There ought to be no difference between a hardware ANN and an emulated ANN for these purposes". ↵
- T. 0306/10. ↵
- "What makes the recommended file worth recommending are its semantic qualities. This is a matter of aesthetics or, in the language used by the Hearing Officer, they are subjective and cognitive in nature. They are not technical and do not turn this into a system which produces a technical effect outside the excluded subject matter. I note that the same view was expressed by the Technical Board of Appeal of the EPO in Yahoo T 0306/10, at paragraph 5.2 in holding whether song recommendations are "good" or "bad" does not amount to a technical effect. EPL make the point that this case was concerned with inventive step but that is only an artefact of the difference in the way the EPO approaches patentability from the manner in which it is approached in this jurisdiction. It does not undermine the relevance of the Board's observation. It is true that as the judge said, the system has gone about its analysis and selection in a technical way but that is because it is an ANN, i.e. a computer. The fact the computer is using properties it can measure to make this semantic recommendation makes no difference. I think the flaw is that this approach imports the undoubtedly technical nature of computer systems (including ANNs) into the analysis. If that was appropriate then the same could be said of the other cases of excluded matter such as the computer implemented financial trading system of Merrill Lynch. It is the semantic similarity of the files here which gives rise to their recommendation but that is not a technical matter at all. Putting it another way the similarity or difference between the two files is semantic in nature and not technical. I agree with the Hearing Officer that the similarity between this case and the one addressed by Floyd J in Protecting Kids is superficial only and also that no useful analogy can be drawn from the patent in Gemstar which was held not to be excluded. The fact that in the present case there is what one might call an external transfer of data (the file recommendation) does not help for the same reason. What matters is the correct characterisation of the data being transferred and that brings the issue back to the aesthetic and therefore non-technical quality of this aspect of the contribution." (points 79 à 81). ↵
- Guidelines for examining patent applications relating to artificial intelligence (AI), version modifiée en mai 2024. ↵
- Scenarios applying the guidelines for examining patent applications for AI. ↵
- Comptroller of Patents v Emotional Perception AI Ltd [2024] EWCA Civ 825. ↵
- Selon les principes posés par Eden Lilly v. Human Genome Science, [2008] EWHC 1903 (Pat), (2008) 31(10) IPD 31066, (2009) 105 BMLR 27, [2008] RPC 29. ↵
- Sch. A2, s.1 (directive, art. 3(1)). ↵
- Sch. A2, s.2 (directive, art. 3(1)). ↵
- « Dans cette annexe: "procédé essentiellement biologique" signifie un procédé d'obtention d’animaux et de végétaux qui consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.« procédé microbiologique » désigne tout procédé comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique.« variété végétale » désigne un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut (a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, (b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et (c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement ». ↵
- V. infra, n°332. ↵
- Notamment CJUE 18 octobre 2011, aff C-34/10, Brüstle c. Greenpeace et/ CJUE 18 décembre 2014, aff C-364/13, International Stem Cell Corporation c. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks sur les dispositions de la directive relatives à l’embryon humain, et CJUE 6 juillet 2010, aff C-428/08, Monsanto Technologu c. Cefetra BV, sur l’article 9 de la directive (transposée à la section 9 de l’annexe A2). ↵
- V. Tome 1, n°32. ↵
- V. en particulier Warner Music UK Ltd & Sony Music UK Ltd v. TuneIn Inc. [2021] EWCA Civ 441; Tome 1, ibid. ↵
- V. supra, n°308. ↵
- La règle sous l’empire du Patents Act 1949 était, comme en France avant la réforme de 1978, celle de la « prior claim approach ». ↵
- SmithKline Beecham Plc’s (Paroxetine Methanesulfonate) Patent [2006] RPC 10. ↵
- "(4) For the purposes of this section the disclosure of matter constituting an invention shall be disregarded in the case of a patent or an application for a patent if occurring later than the beginning of the period of six months immediately preceding the date of filing the application for the patent and either: (a) the disclosure was due to, or made in consequence of, the matter having been obtained unlawfully or in breach of confidence by any person: (i) from the inventor or from any other person to whom the matter was made available in confidence by the inventor or who obtained it from the inventor because he or the inventor believed that he was entitled to obtain it; or (ii) from any other person to whom the matter was made available in confidence by any person mentioned in sub-paragraph (i) above or in this sub-paragraph or who obtained it from any person so mentioned because he or the person from whom he obtained it believed that he was entitled to obtain it; (b) the disclosure was made in breach of confidence by any person who obtained the matter in confidence from the inventor or from any other person to whom it was made available, or who obtained it, from the inventor; or (c) the disclosure was due to, or made in consequence of the inventor displaying the invention at an international exhibition and the applicant states, on filing the application, that the invention has been so displayed and also, within the prescribed period, files written evidence in support of the statement complying with any prescribed conditions. (5) In this section references to the inventor include references to any proprietor of the invention for the time being". ↵
- V. Actavis v Merck [2008] RPC 26. ↵
- Ibid. ↵
- Hospira UK Ltd v Genentech Inc [2014] EWHC 1094, et sur appel, Hospira (UK) Ltd v Genetech Inc [2015] EWCA Civ 57. ↵
- Biogen Inc v Medeva plc [1996] UKHL 18, [1997] RPC 1; Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd, [1985] RPC 59; Molnlycke AB v Procter & Gamble Ltd [1994] RPC 49; Hallen Co v Brabantia (UK) Ltd [1991] RPC 195; Dyson Appliances Ltd v Hoover Ltd [2002] RPC 22; Pozzoli SPA v BDMO SA [2007] EWCA Civ 588. ↵
- Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd, [1985] RPC 59. ↵
- Pozzoli SPA v BDMO SA [2007] EWCA Civ 588. ↵
- Point 23 de l'arrêt: "(1) (a) Identify the notional ‘person skilled in the art’; (b) Identify the relevant common general knowledge of that person; (2) Identify the inventive concept of the claim in question or if that cannot readily be done, construe it; (3) Identify what, if any, differences exist between the matter cited as forming part of the ‘state of the art’ and the inventive concept of the claim or the claim as construed; (4) Viewed without any knowledge of the alleged invention as claimed, do those differences constitute steps which would have been obvious to the person skilled in the art or do they require any degree of invention?" ↵
- Manual of Patent Practice, §§ 3.20 à 3.33.2. ↵
- Ibid, §§ 3.36 à 3.45., qui détaille les règles et les facteurs à considérer dans l'application de cette possibilité. ↵
- Chiron Corp v Murex Diagnostics Ltd and other [1996] RPC 535. ↵
- Human Genome Sciences v Eli Lilly, [2011] UKSC 51, [2012] RPC 6. ↵
- "Like Lord Hope, I derive considerable assistance from the approach set out at T. 0018/09, para 22., which appears to me to be entirely consistent with the Board's earlier jurisprudence (as summarised in para 107) (...) 107. [références précises aux décisions OEB omises] The essence of the Board's approach in relation to the requirements of Article 57 in relation to biological material may, I think, be summarised in the following points: "The general principles are: (i) The patent must disclose "a practical application" and "some profitable use" for the claimed substance, so that the ensuing monopoly "can be expected [to lead to] some … commercial benefit"; (ii) A "concrete benefit", namely the invention's "use … in industrial practice" must be "derivable directly from the description", coupled with common general knowledge; (iii) A merely "speculative" use will not suffice, so "a vague and speculative indication of possible objectives that might or might not be achievable" will not do; (iv) The patent and common general knowledge must enable the skilled person "to reproduce" or "exploit" the claimed invention without "undue burden", or having to carry out "a research programme"; Where a patent discloses a new protein and its encoding gene: (v) The patent, when taken with common general knowledge, must demonstrate "a real as opposed to a purely theoretical possibility of exploitation"; (vi) Merely identifying the structure of a protein, without attributing to it a "clear role", or "suggest[ing]" any "practical use" for it, or suggesting "a vague and speculative indication of possible objectives that might be achieved", is not enough; (vii) The absence of any experimental or wet lab evidence of activity of the claimed protein is not fatal; (viii) A "plausible" or "reasonably credible" claimed use, or an "educated guess", can suffice; (ix) Such plausibility can be assisted by being confirmed by "later evidence", although later evidence on its own will not do; (x) The requirements of a plausible and specific possibility of exploitation can be at the biochemical, the cellular or the biological level; Where the protein is said to be a family or superfamily member: (xi) If all known members have a "role in the proliferation, differentiation and/or activation of immune cells" or "function in controlling physiology, development and differentiation of mammalian cells", assigning a similar role to the protein may suffice; (xii) So "the problem to be solved" in such a case can be "isolating a further member of the [family]"; (xiii) If the disclosure is "important to the pharmaceutical industry", the disclosure of the sequences of the protein and its gene may suffice, even though its role has not "been clearly defined"; (xiv) The position may be different if there is evidence, either in the patent or elsewhere, which calls the claimed role or membership of the family into question; (xv) The position may also be different if the known members have different activities, although they need not always be "precisely interchangeable in terms of their biological action", and it may be acceptable if "most" of them have a common role". ↵
- CDPA1988, s. 276. ↵
- CDPA 1988, s. 274. ↵
- V. Tome 1, n°59. ↵
- CDPA 1988, s. 280. ↵
- V. Tome 1, n° 139. Recommandation 53. ↵
- Patents Act 1977, s. 14(2). ↵
- Patents Act 1977, s. 14(3). ↵
- Patents Act 1977, s. 14(5). ↵
- Patents Act 1977, s. 14(7). ↵
- Patents Act 1977, s. 14(9). ↵
- C’est-à-dire une demande déposée reprenant tout ou partie d’une demande antérieure (parente) pour bénéficier de la même date de dépôt que la demande parente mais y ajoutant des éléments nouveaux. ↵
- Les nouveautés du service brevets sont prévues pour un lancement au premier semestre 2025, et permettront: de consulter, gérer et mettre à jour le portefeuille de brevets britanniques en ligne; des demandes de brevet plus fluides permettant aux demandeurs de soumettre des informations par étapes et dans l’ordre qui leur convient ; d'enregistrer et de partager des projets de demandes d’applications; des vérifications intégrées pour éviter les erreurs et donner un retour instantané sur les problèmes de formatage; et la réutilisation des données du compte pour éviter une nouvelle saisie des informations sur chaque demande. Source: UKIPO, juillet 2024. ↵
- Patents Act 1977, s. 15. ↵
- Patents Act 1977, s. 16. ↵
- Patents Rules 2007 r 26, SI 2007/3291. La publication peut être interdite ou restreinte pour des raisons de sécurité publique. ↵
- Le délai est de deux mois à compter de la nouvelle publication pour les demandes PCT, et est supprimé dans le cas de demandes divisionnaires si le délai de trois mois applicable à la demande parente est écoulé. ↵
- Patents Act 1977, s. 17. ↵
- Accessible ici. ↵
- Service dénommé Patent Cooperation Treaty (PCT) (UK) Fast Track. ↵
- V. l’exposé de ces programmes sur le site de l’Intellectual property office à l’adresse: https://www.gov.uk. ↵
- résultant d'une demande sollicitant à la fois une combined search and examination (CSE), une recherche et/ou un examen accélérés et une publication accélérée (source UKIPO). ↵
- « Un brevet d’invention peut être délivré aux personnes énumérées ci-après exclusivement: a) en principe, à l’inventeur ou aux coïnventeurs ; b) de préférence à ces personnes, à toute personne qui avait droit, en vertu d’une loi ou disposition légale, d’une loi étrangère, d’un traité ou d’une convention internationale ou d’une clause exécutoire d’un accord conclu avec l’inventeur avant la création de l’invention, seule ou conjointement avec une autre personne, au moment de la création de l’invention, à l’ensemble de la propriété de l’invention (autre que les intérêts découlant d’institutions propres au système de l’equity) au Royaume-Uni; c) en tout état de cause, à l’ayant cause ou aux ayants cause des personnes mentionnées aux sous-alinéas a) et b) ou à toute personne précitée et à l’ayant cause ou aux ayants cause de l’une des autres personnes précitées. » (traduction OMPI). ↵
- Patents Act 1977, s. 7(3): « Dans la présente loi, le terme «inventeur» d’une invention s’entend du véritable auteur [deviser] de l’invention et le terme «coïnventeurs» doit être interprété en conséquence. ». Sur les étapes applicables à la détermination de la qualité d’inventeur, V. Henry Brothers (Magherafelt) Ltd v The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office, [1999] RPC 442. ↵
- V. supra, n°312. ↵
- Ibid. ↵
- Patents Act 1977, s. 7(4). ↵
- Patents Act 1977, s. 8, 2 (demandes) et 37 (brevets, la demande devant être faite dans les deux ans de la délivrance). ↵
- Patents Act 1977, s. 39: "Right to employees’ inventions. (1) Notwithstanding anything in any rule of law, an invention made by an employee shall, as between him and his employer, be taken to belong to his employer for the purposes of this Act and all other purposes if: (a) it was made in the course of the normal duties of the employee or in the course of duties falling outside his normal duties, but specifically assigned to him, and the circumstances in either case were such that an invention might reasonably be expected to result from the carrying out of his duties; or (b) the invention was made in the course of the duties of the employee and, at the time of making the invention, because of the nature of his duties and the particular responsibilities arising from the nature of his duties he had a special obligation to further the interests of the employer’s undertaking. (2) Any other invention made by an employee shall, as between him and his employer, be taken for those purposes to belong to the employee. (3) Where by virtue of this section an invention belongs, as between him and his employer, to an employee, nothing done— (a) by or on behalf of the employee or any person claiming under him for the purposes of pursuing an application for a patent, or (b) by any person for the purpose of performing or working the invention, shall be taken to infringe any copyright or design right to which, as between him and his employer, his employer is entitled in any model or document relating to the invention". ↵
- Toute clause contraire est nulle (s. 42). ↵
- Patents Act 1977, s. 40 et, pour les modalités de calcul, s. 41. ↵
- V . par exemple James Duncan Kelly and Kwok Wai Chiu v. GE Healthcare Ltd [2009] EWHC 181 (Pat). En l’espèce, la High Court a considéré que le bénéfice exceptionnel visé par la loi était démontré par la circonstance que les brevets en cause pouvaient être valorisés au moins à 50 millions de livres et qu'ils avaient été un élément décisif d'opérations de fusion acquisition opérées par l'employeur. Pour la cour, la participation des employés peut aller jusqu'à 33 %. En l'espèce, le pourcentage total a été fixé à 3 % (1,5 million de livres). La décision a été rendue sur le fondement du Patents Act 1977 avant sa révision en 2005, qui ne prévoyait pas la compensation lorsque l'invention elle-même (et non plus seulement le brevet) a été d'un bénéfice exceptionnel pour l'employeur. ↵
- V. Patents Act 1977, s. 24(4). ↵
- Patent Rules 2007, SI 2007/3291, r 10 ↵
- Patents Act 1977, s. 30(1). ↵
- Patents Act 1977, s. 30(1) et (2). ↵
- Patents Act 1977, s. 29(1). ↵
- Patents Act 1977, s. 29(2). ↵
- Patents Act 1977, s. 29(3). ↵
- «(3) If the comptroller is satisfied that the patent may properly be surrendered, he may accept the offer and, as from the date when notice of his acceptance is published in the journal, the patent shall cease to have effect, but no action for infringement shall lie in respect of any act done before that date and no right to compensation shall accrue for any use of the patented invention before that date for the services of the Crown ». ↵
- Patents Act 1977, s. 36(1). ↵
- Patents Act 1977, s. 36(2). ↵
- Patents Act 1977, s. 36(3). ↵
- Patents Act 1977, s. 36(5). ↵
- V. United Wire Ltd v Screen Repair Services (Scotland) Ltd [2000] UKHL 42, [2001] RPC 24 (la réparation d’un produit breveté ne constitue pas une fabrication) ; Schütz (UK) Ltd v Werit UK Ltd [2013] UKSC 16 (à propos du remplacement d’un composant d’un produit breveté ; en l’espèce, le remplacement d’une pièce accessoire, remplaçable, sans rapport avec le concept inventif revendiqué, jugé non contrefaisant) ; Nestec SA & Ors v Dualit Ltd & Ors [2013] EWHC 923 (Pat) (invention consistant dans une machine à café et une capsule adaptée. Jugé que l’achat de capsules par les propriétaires de la machine ne constitue pas une fabrication). ↵
- V. Kalman and another v PCL Packaging (UK) Ltd and another [1982] F.S.R. 406 (un simple transporteur ne distribue pas au sens de ce texte). ↵
- V. Smith, Kline and French Laboratories Ltd v R D Harbottle (Mercantile) Ltd and Others [1980] RPC 363. ↵
- V. Union Carbide Corp v BP Chemicals Ltd [1999] RPC 409 (une mauvaise utilisation d’un procédé breveté demeure contrefaisante). ↵
- Exception précisée en matière de médicaments par la section 60. « Section 60(6D): For the purposes of subsection (5)(b), anything done in or for the purposes of a medicinal product assessment which would otherwise constitute an infringement of a patent for an invention is to be regarded as done for experimental purposes relating to the subject-matter of the invention.Section 60(6E): In subsection (6D), “medicinal product assessment” means any testing, course of testing or other activity undertaken with a view to providing data for any of the following purposes:a) obtaining or varying an authorisation to sell or supply, or offer to sell or supply, a medicinal product (whether in the United Kingdom or elsewhere);b) complying with any regulatory requirement imposed (whether in the United Kingdom or elsewhere) in relation to such an authorisation;c) enabling a government or public authority (whether in the United Kingdom or elsewhere), or a person (whether in the United Kingdom or elsewhere) with functions of:(i) providing health care on behalf of such a government or public authority, or(ii) providing advice to, or on behalf of, such a government or public authority about the provision of health care, to carry out an assessment of suitability of a medicinal product for human use for the purpose of determining whether to use it, or recommend its use, in the provision of health care.Section 60(6F): In subsection (6E) and this subsection: “medicinal product” means a medicinal product for human use or a veterinary medicinal product;“medicinal product for human use” has the meaning given by article 1 of Directive 2001/83/EC(a);“veterinary medicinal product” has the meaning given by article 1 of Directive 2001/82/EC(b).Section 60 (6G): Nothing in subsections (6D) to (6F) is to be read as affecting the application of subsection (5)(b) in relation to any act of a kind not falling within subsection (6D) ». ↵
- L’Annexe A1 du Patents Act 1977 précise les conditions d’application de l’exception. V. également Section 60(6C). ↵
- V. n°333. ↵
- Le premier arrêt anglais est Betts v. Willmott (1871) Ch. App. 239 (le titulaire du brevet ne peut s'opposer à l'importation et à la vente d'un produit breveté vendu à l'étranger sans aucune restriction). ↵
- La rédaction issue du Patents Act 1977 (section 60 (1)) reprend les termes de la Convention de Luxembourg, et est proche de la rédaction française de l'article L. 613-3. ↵
- Lord Bridge dans l'affaire British Leyland v Armstrong Patents (1986) F.S.R. 221 (H.L.), relative à la fabrication de pièces détachées (tuyaux d'échappement) en violation du modèle déposé par le constructeur. En l'espèce la Chambre des Lords utilisera une théorie de droit des biens (non derogation from a grant) interdisant au vendeur d’agir de façon à restreindre la jouissance, par l’acheteur, du bien vendu. V. supra, n°258. ↵
- Juge Buckley dans l'arrêt Badische Anilin und Soda Fabrik v Otto Isler (1906) 23, RPC 173 p 180, cité et traduit in Le Stanc, L’acte de contrefaçon de brevet d’invention, Litec 1977, p 100. Cf. L.W. Melville, Precedents on Intellectual Property and International Licensing, Sweet & Maxwell, 1972, 1-19 p 14. Egalement Sirdar Rubber Co. ltd. v. Wallington Western and co, (1905) 22 RPC 257, (1907) 24 RPC 539 (H.L.), à la p 543; Solar Thomson Engineering Co ltd. v. Barton (1977) RPC 537 (CA), pp 547 et 554-55. ↵
- United Wire Ltd v Screen Repair Services (Scotland) Ltd, [2000] UKHL 42, [2000] 4 All ER 353, [2001] RPC 439, [2001] F.S.R. 365, [2000] IP & T 1038, [2000] All ER (D) 1025. ↵
- Ibid. V. également Dunlop Pneumatic Tyre v Neal [1899] 1 Ch 807, (1899) 16 RPC 247 ; Solar Thomson Engineering v Barton [1977] EPC 53 ; Dellareed v Delkim Developments [1988] FSR 329. ↵
- Une section 60(4) du Patents Act reprenait les dispositions de la Convention de Luxembourg sur ce point, mais n’est jamais entrée en vigueur et a été supprimée en 2004. ↵
- Tome 1, n° 32. ↵
- Intellectual Property (Exhaustion of Rights) (EU Exit) Regulations 2019, SI 2019 No. 265. ↵
- SI 2019 No. 265. ↵
- Patents Act 1977, nouvelle section 60(3): "(3A) Subsections (1) and (2) shall not apply to an act done in relation to a product that is subject to a patent where the product has been put on the market in the United Kingdom or the European Economic Area by or with the consent of the proprietor of the patent unless— (a) (b) there exist legitimate reasons for the proprietor of the patent to oppose the act for the purpose of protecting the proprietor’s property, and the opposition to the act interferes with the rights of any other person no more than is necessary to achieve that purpose". ↵
- Betts v Wilmott (1870–71) LR 6 Ch App 239 (importation au Royaume-Uni de capsules brevetées fabriquées en France par l’agent du titulaire du brevet anglais, étant précisé que le brevet français était expiré). ↵
- Roussel Uclaf v Hockley International [1996] RPC 441 et Zino Davidoff v A&G Imports [2000] Ch 127 (importation possible en l’absence de restriction portée à la connaissance de l’importateur); Société Anonyme des Manufactures de Glaces v Tilghman’s Patent Sand Blast Company (1884) LR 25 Ch D 1 (le produit importé n’avait été fabriqué à l’étranger par le titulaire du brevet anglais, mais par son licencié; jugé que le licencié est tenu des termes restrictifs de la licence); The Wellcome Foundation v Discpharm [1993] FSR 433 (donne effet à une restriction d’importation imposée par le titulaire du brevet et portée à la connaissance d’importateurs; V. J. Jones, Exhaustion of Rights: Pharmaceuticals Marketed in Spain: a Wellcome Exception [1993] EIPR 107). ↵
- Ce qui exclu la simple possession: Helitune Ltd. v. Stewart Hughes Ltd., [1991] F.S.R. 171; Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd. [1998] EWCA Civ 744, 743, [1998] RPC 727 (CA). ↵
- Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd., précité. ↵
- Ibid. ↵
- Patents Act 1977, s. 59. ↵
- Patents Act 1977, s. 57A. Sauf lorsque où l’invention a été, avant sa date de priorité, dûment inscrite ou expérimentée par ou au nom et pour le compte d’un ministère ou de l’Agence du Royaume-Uni pour l’énergie atomique autrement qu’en conséquence d’une communication pertinente faite sous le sceau du secret (Section 55(3)). ↵
- En substance, les stipulations de ces contrats sont sans effets dans la mesure où elles limitent ou réglementent l’exploitation de l’invention par la Couronne en vertu de l’article 55. Une compensation monétaire est également prévue. ↵
- Dans les conditions prévues par la section 58. ↵
- Patents Act 1977, s. 25(1). ↵
- Les Patents (Compulsory Licensing and Supplementary Protection Certificates) Regulations 2007 ont précisé les dispositions du Patents Act applicables aux certificats et demandes de certificats en insérant la section 128B et l’Annexe4A du Patents Act 1977. Les Patents Rules 2007 et les Patents (Fees) Rules 2007 précisent les procédures et redevances applicables. ↵
- Patents Act 1977, s. 30. ↵
- Ibid. ↵
- Patents Act 1977, s. 30(4). ↵
- Ibid. ↵
- Patents Act 1977, s. 30(6) (sous reserve de l’application des règles d’équité). ↵
- Patents Act 1977, s. 30(7). ↵
- Patents Act 1977, s. 33, Rule 47. ↵
- Patents Act 1977, s. 47. ↵
- Patents Act 1977, s. 51. ↵
- Patents Act 1977, s. 48(5). ↵
- Patents Act 1977, s. 48A(1). ↵
- Patents Act 1977, s. 48A(2). ↵
- Patents Act 1977, s. 48A(3). ↵
- Patents Act 1977, s. 48A(6). ↵
- Patents Act 1977, s. 48B. ↵
- Patents Act 1977, s. 25(3). ↵
- Patents Act 1977, s. 28(3) telle que modifiée par le Regulatory Reform (Patents) Order 2004, SI 2004/2357 (la condition antérieure était la démonstration d’un « reasonable care »). ↵
- V. supra, n°331. ↵
- V. par exemple Menashe Business Mercantile Ltd v William Hill Organisation Ltd, [2002] EWCA Civ 1702, [2003] 1 All ER 279, [2003] 1 WLR 1462, [2003] RPC 31 (28 November 2002), Court of Appeal (brevet portant sur un système informatique comprenant un serveur, des terminaux communicants et des logiciels. Jugé, en première instance, que le brevet n’était pas non contrefait par la fourniture au Royaume-Uni de logiciels permettant de communiquer avec le serveur, dans la mesure où ce dernier était situé aux antielles Néerlandaises. Infirmé en appel, au motif que la localisation géographique du serveur n’était pas pertinente, seul important de déterminer la localisation des personnes qui utilisent le système). ↵
- Il a été défini comme suit par la Cour d’appel dans l’arrêt Grimme v Scott, [2010] EWCA Civ 1110 : « the knowledge and intention requirements of (…) section 60(2) are satisfied if, at the time of supply or offer of supply, the supplier knows, or it is obvious in the circumstances, that ultimate users will intend to put the invention into effect. That is to be proved on the usual standard of balance of probabilities. It is not enough merely that the means are suitable for putting the intention into effect (for that is a separate requirement), but it is likely to be the case where the supplier proposes or recommends or even indicates the possibility of such use in his promotional material ». ↵
- Patents Act 1977, s.61(1). ↵
- Patents Act 1977, s. 67(1). ↵
- Patents Act 1977, s. 67(3). ↵
- Patents Act 1977, s. 66(2). ↵
- Patents Act 1977, s. 68. ↵
- Voir supra, n°46. ↵
- Auparavant, les litiges étaient portés devant la Patents court, qui constituait une émanation de la High Court. ↵
- qui dispose : « L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers ». ↵
- Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd [1982] RPC 183. ↵
- Lord Diplock. ↵
- LG Philips LCD Co Ltd v Tatung (UK) Ltd [2006] EWCA Civ 1774, [2007] RPC 124. ↵
- "The mere fact that a word, phrase or other provision in a patent claim is not wholly clear will not, by any means, automatically lead to the conclusion that the claim is objectionable. That would involve setting a far too high and unrealistic standard for drafting in any field; it would be particularly inappropriate to adopt such an approach to the drafting of patents, a notoriously difficult exercise in many cases. A claim needs to be as clear as the subject matter reasonably admits of." n°20. ↵
- Improver Corp v Remington Consumer Products Ltd, [1990] F.S.R. 181, [1989] RPC 69, par Hoffmann J. ↵
- « If the issue was whether a feature embodied in an alleged infringement which fell outside the primary, literal or acontextual meaning of a descriptive word or phrase in the claim ('a variant') was nevertheless within its language as properly interpreted, the court should ask itself the following three questions: 1 ) Does the variant have a material effect on the way the invention works? If yes, the variant is outside the claim (and does not infringe). If no? 2) Would this (ie that the variant had no material effect) have been obvious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art? If no, the variant is outside the claim. If yes? 3) Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention? If yes, the variant is outside the claim. On the other hand, a negative answer to the last question would lead to the conclusion that the patentee was intending the word or phrase to have not a literal but a figurative meaning (the figure being a form of synecdoche or metonymy') denoting a class of things which included the variant and the literal meaning, the latter being perhaps the most perfect, best- known or striking example of the class ». ↵
- V. Mayne Pharma Pty Ltd v Pharmacia Italia SpA [2005] EWCA Civ 137. ↵
- L’article 2 du protocole interprétatif de l’article 69 CBE, introduit par la révision de la Convention du 29 novembre 2000, dispose désormais que « Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ». ↵
- V. supra, n°345. ↵
- V. Tome 1, n°51. A noter que deux défenses spécifiques fondées sur des considérations de concurrence, issues des sections 44 et 45 du Patents Act, ont été abrogées par le Competition Act 1998. Leur contenu a été absorbé par les dispositions générales désormais applicables. ↵
- V. Tome 1, n°164. ↵
- V. Tome 1, n°60. ↵
- Ce texte dispose (traduction OMPI modifiée) : « 70. 1) Lorsqu’une personne (propriétaire ou non du brevet ou ayant ou non un droit sur le brevet) menace une autre personne d’une procédure en contrefaçon du brevet par des circulaires, des moyens publicitaires ou autres, la personne lésée par les menaces (qu’elle soit ou non la personne à qui elles sont destinées) peut, sous réserve de l’alinéa 4), engager contre leur auteur une procédure judiciaire et demander l’une des réparations prévues à l’alinéa 3).2) Dans une procédure de ce genre, sous réserve des dispositions du paragraphe (2A) ci-dessous, le demandeur qui prouve que de telles menaces ont été faites et convainc le tribunal qu’il est lésé par elles a droit à la réparation demandée2A) Si le défendeur prouve que les actes sur lesquels porte la menace de procédure constituent ou constitueraient une contrefaçon du brevet :a) le demandeur ne bénéficiera du remède demandé que s’il démontre que le brevet prétendument contrefait est nul à cet égard ;(b) même si le demandeur démontre que le brevet est nul à cet égard, il ne bénéficiera pas du remède demandé si le défendeur prouve qu’au moment où les menaces ont été faites, il ne savait pas, et n’avait pas de raison de savoir, que son brevet était nul à cet égard.3) Cette réparation consiste en a) une déclaration selon laquelle les menaces sont injustifiées;b) une ordonnance interdisant la poursuite des menaces; etc.) des dommages-intérêts pour tout préjudice subi par le demandeur en raison des menaces.4) Une procédure ne peut pas être engagée en vertu du présent article pour (a) une menace d’engager une procédure en raison d’une contrefaçon dont il est allégué qu’elle consiste dans la fabrication ou l’importation d’un produit en vue d’en disposer ou l’utilisation d’un procédé.(b) une menace, faite à une personne qui a fabriqué ou importer un produit en vue d’en disposer ou a utilisé un procédé, d’agir en contrefaçon pour un autre acte en relation avec ce produit ou procédé.5) Pour l’application de la présente section une personne ne menace par une autre personne d’agir en contrefaçon d’un brevet s’il elle se contente de (a) fournir des informations factuelles sur le brevet ;(b) poser des questions à l’autre personne aux seules fins de découvrir si, et par qui, le brevet a été contrefait comme mentionné dans la sous-section (4)(a) ci-dessus ; ou (c) présente des affirmations sur le brevet aux fins de telles demandes ». ↵
- Patents Act 1977, s. 74. ↵
- V. supra, n°46. ↵
- Les décisions de l’IPO font l’objet d’un appel devant la Patents Court. ↵
- A noter que la procédure de revocation peut porter sur un brevet européen (RU). ↵
- Patents Act 1977, s. 72(1). ↵
- CBE, art. 100(a) à (c). ↵
- Patents Act 1977, s. 72(2). V. supra, n°295 sur la procédure devant l’IPO. ↵
- Patents Act 1977, s. 74(A). L’opinion n’est pas contraignante. Le Contrôleur peut, à cette occasion décider de révoquer le brevet pour défaut de nouveauté dans les conditions posées par la section 73 précitée. ↵
- V. Mallory Metallurgical Products Limited v Black Sivalls and Bryson incorporated [1977] RPC 321: « the description must be sufficiently clear and precise to enable the court to declare that an article corresponding with the description would not constitute an infringement. The burden of proving the absence of infringement rests, in my judgment, upon the plaintiff. If there be lack of clarity or precision, the court is not in a position to grant the declaration sought ». ↵
